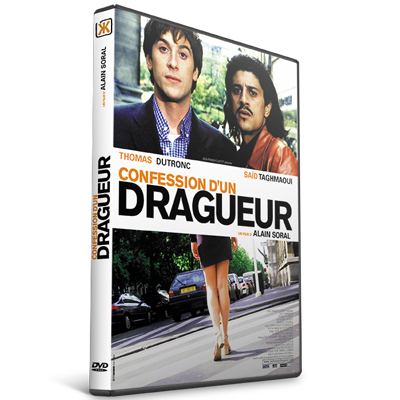Préambule :
En 1826, Joseph Nicéphore Niépce, de Chalon-sur-Sâone, inventa la photographie, que son compatriote Louis Daguerre améliora en 1839. L’État français rachète les droits afin de les offrir « au monde ».
Le berceau :
« Mon cher ami, je suis en train de refaire Shakespeare. Ce qu’il a passé à coté de belles choses, cet animal-là... »
C’était vers 1908. On sourit devant l’arrogance de la bourgeoisie lettrée et affairiste du début du XXème siècle qui fera tant d’efforts pour sortir le cinéma du bain populaire dans lequel, il faut bien le dire, il végétait un peu ; un truc d’andouilles, de bouffonnerie sans avenir... à la déconnante totale. Ainsi nos lettrés ont décidé : le cinéma sera art ! Le septième ! Place au sérieux.
Mais commençons par le début. Sans remonter jusqu’aux ombres projetées, on peut tout de même évoquer Émile Reynaud et son théâtre optique qui projetait sur un écran des dessins animés appelés pantomimes lumineuses. Nous sommes au musée Grévin en 1888.
Au même moment, Louis Le Prince réalise un film, Une scène du jardin de Roundhay [1], à l’aide de sa camera brevetée. Filmé à Leeds en Angleterre, ce court métrage de 2,11 secondes est le premier film de l’histoire du cinéma.
Ce chimiste français disparaît mystérieusement en 1890 alors qu’il semblait aboutir. Il s’est pour ainsi dire envolé du train qui l’amenait à Paris. L’aventure s’arrête là.
Léon Bouly, en 1892, invente un appareil capable de prises de vue et de projection et lui donne le nom de « Cinématographe ». Faute d’argent, il ne pourra protéger le nom de son invention.
Plus tard, en 1895, les frères Lumière (photo ci-dessus) font breveter la leur (à la fois caméra de prise de vue, tireuse et projecteur) qui supplantera toutes les autres et pour laquelle ils reprendront le nom de cinématographe devenu disponible. Ces deux ingénieurs filment alors à Lyon-Montplaisir la Sortie des Usines Lumière [2] qui impressionne lors de projections privées.
Suivent rapidement les premières représentations publiques payantes qui auront lieu dans le sous-sol du Grand Café, boulevard des Capucines. Pour un franc, on peut voir dix de leurs films de dix-sept mètres chacun (environ une minute). Les sujets sont variés : une pêche aux poissons rouges, une voltige, un forgeron, un jardinier [3], un repas... la mer qui excite l’enthousiasme par « la vérité si vraie, si vague, si colorée, si remuante ». Plus tard, on y ajoutera la célèbre Arrivée du train en gare de La Ciotat [4]. Un choc ! Et le phénomène fut rentable : en trois semaines, sans publicité, les bénéfices étaient déjà considérables.
Il n’en fallait pas plus. Sans attendre, les bandes de celluloïd envahirent Paris. Pour 50 centimes on avait droit à vingt ou trente minutes de plaisir. Un piano accompagnait la projection et les « bruiteurs », en coulisse, s’en donnaient à cœur joie.
Les frères Lumière virent les concurrents et les brevets se multiplier. Léon Gaumont perfectionna le chronophotographe inventé en 1894 par Georges Demeny. Charles Pathé construisit avec Henry Joly l’appareil de prise de vue mouvementée Joly. Les rivalités entre les maisons productrices de films s’affirmèrent de plus en plus. Le format restait court et les sujets s’encraient dans la réalité immédiate. On filmait des maçons à l’ouvrage, des plongeurs, un menuisier à son établi, le salon d’un barbier, des défilés, l’arrivée du Tsar, les grandes eaux de Versailles... On refit 10 arroseurs arrosés, 20 courses de sergents de ville, on cherchait à tâtons une forme comique adaptée. On fabriquait, on vendait directement aux exploitants, pour la plupart forains. Une originale, Alice Guy, eut l’idée de faire jouer une scène devant un objectif : un barbouilleur peignit une toile représentant la rue de Belleville et son funiculaire, on racola un employé et un apprenti, et ce fut le premier film narratif de Léon Gaumont.
Une échappée
Cette forme anecdotique, berceau du cinéma, fatigua les frères Lumière qui n’y voyaient qu’un jouet susceptible, tout au plus, de servir quelques applications scientifiques et qu’on pourrait, à la rigueur, exhiber durant quelques mois. Une futilité. Charles Pathé et Léon Gaumont, quant à eux, réalisèrent très vite le potentiel commercial du joujou. L’un et l’autre allaient donner à la production de films sa forme industrielle. La maison Pathé imprimait des positifs comme aujourd’hui on imprime des billets et la Gaumont dés 1905 possédait le plus grand studio de cinéma du monde.
Rappelons que, jusque là, le cinéma américain fut intégralement à la remorque de la production française, on vit ses studios reproduire scènes comiques à court métrage et duos amoureux en série. Une grande partie des bandes projetées n’était pas autre chose que des contrefaçons de négatifs français. Edison mit tout en œuvre pour monopoliser cette industrie prometteuse ; il élimina la filiale américaine des frères Lumière, entreprit des campagnes de procès contre la pléiade de petits producteurs émergents, créa une police privée. On le voit, l’Amérique prenait la chose très au sérieux. Elle considérera toujours le cinéma comme une très féconde et valorisante industrie. La France, quant à elle, n’était pas assez vicieuse. Elle s’exporta bien mais se défendit mal.
Un homme s’est déjà démarqué de cette frénésie. Un bricoleur touche-à-tout et inventif, curieux et un peu baroque, directeur du théâtre Robert-Houdin depuis huit ans lorsque les frères Lumière présentèrent leur invention. Attiré par la prestidigitation, Georges Méliès avait monté des spectacles de pantins, inventé des appareils, créé de grandes illusions. À la fois magicien, metteur en scène, créateur de costumes, de décors, directeur de casting, il allait offrir son univers rempli de vagabonderies, de naïvetés et de féeries au cinéma naissant.
Il commença comme tout le monde mais se lassa très vite des défilés et des arrivées de trains. Il comprit très tôt qu’il fallait renoncer aux scènes prises sur le vif pour se placer dans la ligne du spectacle, de l’invention et de l’imprévu. Que l’intérêt dramatique serait porteur. Nous y voilà !
Il réalise en 1896 L’escamotage d’une dame au théâtre Robert-Houdin [5], puis Le manoir du diable [6] Le hasard ou le souvenir de son théâtre inspireront à Méliès des idées de trucages et autres fantaisies. Il se spécialise dans les substitutions insolites et régale son public de métamorphoses burlesques. Les armures deviennent vivantes dans son Guillaume Tell [7] ; dans L’homme de tête, il met au point la technique dite « d’incrustation » (1898) ; il dédouble son personnage dans L’homme orchestre (1900) [8] ; il jongle avec sa tête dans Le mélomane (1903) [9]
Un rêve
Ce grand artiste infatigable, pionnier de tous les genres cinématographiques, donna au cinéma ses multiples visages… Et il inventa tout ! Le « fondu » qui supprimait les coupures brutales entre les scènes, puis la surimpression. Il mit au point l’utilisation de caches, fit usage du ralenti et de l’accéléré. On tournait en extérieur, au soleil, mais Méliès trouva excellents les résultats en intérieur sous lumière artificielle. C’était en 1897, le Studio venait de naître. Dans les premiers films de la Gaumont, les travailleurs de l’ombre connaissaient fréquemment les honneurs de la rampe ; le mécano, l’électricien, les menuisiers et même les apprentis. On faisait les pitres ! Puis on pensa à des comédiens... et ce fut pire. Il gesticulaient, ouvraient grand la bouche, se frappaient la poitrine, ne comprenaient rien et ne faisaient rien comprendre. Faut dire qu’ils avaient du mépris pour cet art de saltimbanques et de bras cassés. Fatigués, les producteurs décidèrent de jouer eux-mêmes dans leurs films ou d’enrôler leur famille. Ce fut le cas de Méliès, protagoniste de tous ses films.
Déjà singulier, il se démarqua davantage, et particulièrement dans ses longs métrages, par ses rêveries, son imaginaire poétique. Méliès, qui avait arraché le cinéma à sa destinée précaire, proposa de l’amener dans un domaine plus libre, plus enchanteur. Le cinéma devait reprendre le rôle de l’éternel conteur. Il s’employa à la création de décors somptueux, imagina une flore féerique ainsi que d’innombrables objets et sites irréels. Il commença alors sa série de superproductions de deux cents à quatre cents mètres : Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, Barbe bleue… Bientôt, tous les contes de fées y passèrent. Costumes inoubliables, lézards changés en laquais, rats transformés en cochers, somptueuses machines, trucages fous… Ce fut une sorte de révélation, l’imagination n’ayant plus de limite. Bientôt la science et ses mirages envahirent cette féerie.
La foire du Trône fit un triomphe au célèbre Voyage dans la lune (1902) [10]. Pillé et contrefait dans le monde entier, ce film fit connaître le nom de Méliès et lui assura son règne éphémère. Le Voyage de Gulliver [11], réalisé la même année, consacra le succès du film irréaliste. Vitesse, vaisseaux, stalactites, astrolabes, en se combinant au reste, donnèrent de délicieuses et cocasses intrigues. Alors fut le Raid Paris Monte-Carlo en deux heures, Deux cent mille lieues sous les mers, Le Voyage à travers l’impossible… autant d’usines à rêves, d’engins étranges, d’astronomes barbus qui révélaient une nouvelle forme de comique. Tout un univers très populaire, qui attirait les bonnes et les ouvriers pendant que les maîtres allaient au théâtre.
Le glas
L’homme d’affaires n’étant pas à la hauteur du saltimbanque génial, sa société la Star-Film ne put contenir le formidable élan de la machine industrielle Pathé. Lucide et résigné, il déclara : « Laissons les profits au capitaliste acheteur et marchand, soit, mais laissons au réalisateur sa gloire, ce n’est pas trop demander, en bonne justice ». Il avait compris le monde.
Le cinéma changea de cap quelques années avant la grande guerre. Le public ne se renouvelant pas, la petite bourgeoisie décideuse décida. Elle reprocha aux films comiques d’être toujours les mêmes, et aux autres d’être grotesques. Il fallait réhabiliter le cinéma, lui trouver des sujets nobles, l’élever jusqu’au sérieux… faux col et manchettes, fini les voitures astrales ; l’ère du romanesque, du liturgique, de l’actualité pointait le bout de son nez.
Georges Méliès cessa toute activité cinématographique en 1913. Le théâtre Robert-Houdin, qui était devenu un cinéma avec séance de prestidigitation le dimanche, fut fermé dès le début de la guerre sur ordre de la police. On le retrouvera en 1925, vendeur dans une boutique et marié à son actrice fétiche des débuts, Jeanne d’Alcy. Il aura marqué par son audace, ses inventions et sa virtuosité d’équilibriste l’univers cinématographique mondial. Très sérieux dans le travail, ses films sont un vaste champ d’andouilleries cosmiques et de rêveries enfantines qui peuvent nous consoler de tant de films modernes secs et prétentieux. Le déshabillage impossible (1900) [12] fait encore rire, et après le visionnage de quelques-unes de ses fantaisies, on regrette le temps où les anges jaillissaient des horloges et les femmes de l’ombrelle d’un jongleur. Et même si ses films sont encore prisonniers de l’optique théâtrale et encombrés de traditions, ils nous invitaient au rêve. C’est pourquoi son cinéma est encore regardable contrairement aux films de ses concurrents, qui pour la plupart n’ont plus qu’un intérêt documentaire.
La France continuera d’insuffler au cinéma son savoir-faire dans un genre précieux : l’art du comique. Max Linder, qui marquera les esprits par la discrétion elliptique de son jeu (faisant passer les autres acteurs pour frénétiques), inspirera beaucoup de monde et notamment Charles Chaplin.
Jacques Tati appartiendra à cette filiation bien française de l’imaginaire féerique et du burlesque naïf contre les réalités brutales du modernisme argenté [13]
Ce survol a été inspiré par le livre de M. Bardèche et R. Brasillach, "Histoire du cinéma". On pourra même remarquer quelques plagiats.













 et
et  !
!