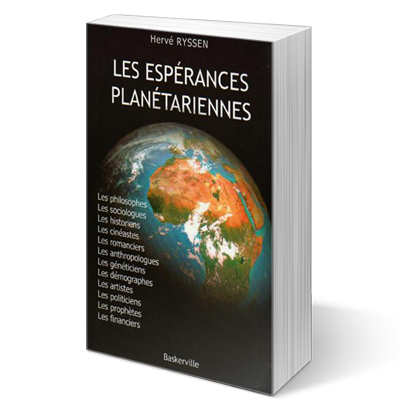Alain Finkielkraut insiste sur la préservation d’un héritage culturel qui devrait être transmis aussi bien aux autochtones qu’aux nouveaux arrivants.
Fils unique de deux orphelins juifs polonais arrivés en France dans les années 1930, Alain Finkielkraut, dont le père survécut à Auschwitz, est né à Paris le 30 juin 1949. Reçu à l’École normale supérieure en 1969, puis à l’agrégation de lettres modernes en 1972, versé depuis toujours dans l’histoire des idées et la philosophie politique, et tôt bercé par les influences d’Emmanuel Levinas, Hannah Arendt ou Charles Péguy, le philosophe n’a jamais cessé, au fil de ses livres, de développer une critique de la modernité et du progressisme, vénérant l’héritage et la transmission au détriment du relativisme, de la bien-pensance, de la repentance et de la mauvaise conscience qui dominent l’air du temps.
Farci d’humour mais d’un naturel extrêmement tourmenté, il manque rarement une occasion de monter au créneau et de soulever la polémique, avec le talent « aristocratique » – comme dirait son vieil ami Pascal Bruckner – d’aller seul contre tous. Lui-même animateur de l’émission Répliques sur France Culture, il est invité désormais sur tous les plateaux qui comptent, où il dispense une parole continûment en mouvement, lucide, brillante et limpide, à défaut d’être tempérée.
S’il a le don de susciter d’innombrables animosités, il peut exciper en revanche de solides amitiés, celles d’Élisabeth de Fontenay ou de Milan Kundera entre autres. Fort d’un soutien inconditionnel à Israël, il est le cofondateur, avec Benny Lévy et Bernard-Henri Lévy, de l’Institut d’études lévinassiennes à Jérusalem. Son maître ouvrage, jusqu’ici, demeure probablement La Défaite de la pensée, paru en 1987, où devait débuter un combat sans merci contre la barbarie du monde moderne.
Propos recueillis par Éric de Bellefroid.
Pourquoi le débat suscité en France autour de votre dernier livre, L’identité malheureuse, est-il si vif ?
Parce que la France a peur de son ombre. Elle ne s’est jamais vraiment remise de l’épisode de la collaboration, et s’attache à prévenir le retour de ses vieux démons, ayant beaucoup de mal à penser ce que notre situation a d’inédit. L’intelligentsia progressiste ne croit plus au progrès mais à l’éternel retour, convaincue que le ventre est toujours grand ouvert, d’où a surgi la bête immonde. Elle pense sincèrement que les musulmans aujourd’hui tiennent le rôle des juifs dans les années 1930. Elle pense aussi que l’inquiétude identitaire relève de la peur de l’étranger et que, dans un contexte de crise économique, on cherche un bouc émissaire. Ce seraient donc les immigrés qui font les frais de cette régression. Je ne sous-estime pas cette menace, mais je pense que nous vivons une situation inédite, non une réédition. Il n’y avait pas, dans les années trente, de territoires perdus de la République ; pas de quartiers sensibles où les pompiers étaient accueillis à coups de pierres, les pharmaciens obligés de fermer boutique, les médecins contraints de déménager pour leur sécurité, et les professeurs victimes d’agressions, lorsque l’injure « sale Français » rejoint le « sale juif » d’autrefois.
Le vivre-ensemble, dites-vous, est en crise. À quoi est-ce imputable ?
La crise actuelle de l’intégration n’est pas imputable au nationalisme français. On me reproche essentiellement de dire cela. On dit que je contribue à la lepénisation des esprits parce que je me refuse à ramener la réalité que nous vivons au schéma classique du fascisme et de l’antifascisme. La France est le théâtre de deux crises conjointes : une crise de l’intégration et celle de la transmission. Ce pays semble se démettre de son héritage au moment où toute une partie de la population refuse de le faire sien. Je crois d’ailleurs que ce problème, s’il est très aigu en France, ne lui est pas propre. L’Europe est devenue un continent d’immigration malgré elle, et elle hésite entre le modèle assimilateur et le modèle multiculturel. Si l’on en croit les instructions de la Commission européenne, elle a choisi le second modèle ; or, celui-ci ne fonctionne pas mieux que le premier. La tension est à son comble dans tous les pays européens.
Vous doutez profondément de l’entrée dans une ère post-nationale.
C’est dans les nations, dans le cadre national qu’a pu, en Europe, s’épanouir la démocratie. Une démocratie post-nationale est-elle donc possible ? J’en doute en effet. Même avec son Parlement, l’Union européenne ne peut être une démocratie, mais bien en revanche une bureaucratie. Dans une société multiculturelle, chacun risque de se déterminer en fonction de son identité régionale ou religieuse. C’en sera fait, dès lors, de la communauté des citoyens. Je pense donc que nous avons tout à perdre à sortir de la nation.
Quelle identité l’Europe doit-elle par conséquent affirmer ?
Il faudrait que l’Europe ait le courage d’affirmer une identité. Pour s’extraire une fois pour toutes des ornières de sa belliqueuse histoire, elle voudrait se constituer autour de valeurs universelles. Ainsi oublie-t-elle qu’elle est une civilisation particulière, qui doit transmettre l’essentiel aux générations futures. J’invite l’Europe à revenir sur terre et à accepter son identité. Elle a beaucoup de mal à le faire, notamment lorsque se pose la question de l’entrée de la Turquie dans l’Union. L’Europe, face à la Turquie, ne veut pas assumer sa différence. Peu importe la spécificité de l’histoire, la cohérence de l’héritage commun aux nations qui la constituent, seul compte à ses yeux le respect des droits de l’homme. Mais raisonner ainsi, c’est dire que n’importe quel pays démocratique a vocation à devenir européen, quelle que soit son histoire ou sa situation géographique. Pourquoi pas le Japon ?
Il faut donc se méfier du multiculturalisme ?
D’abord, il faudrait rendre justice à l’assimilation. Assimiler, ce n’est pas éliminer la différence, ni soumettre tous les individus à un modèle unique. Je ne me suis personnellement pas assimilé à la culture française, il m’a été donné par l’école de m’y assimiler et de m’enrichir de cet héritage. Aujourd’hui, on voudrait remplacer cette assimilation non plus seulement par l’intégration, mais par l’inclusion – un nouveau concept qui circule dans les ministères. Autrement dit, il n’y a plus de dissymétrie entre la culture d’origine et la culture des nouveaux arrivants ; tout est mis à égalité. Je pense que ce n’est plus vivable.
Une nation n’est pas un aéroport ou une salle des pas perdus, et il est normal que ceux qui y vivent depuis longtemps puissent continuer de se sentir chez eux. Il est légitime aussi que le mode de vie majoritaire s’impose aux nouveaux arrivants, il en va de la survie même de la civilisation française. La coexistence des cultures n’est harmonieuse que dans les magasins : toutes les cuisines, toutes les musiques peuvent cohabiter. Dans la vie, c’est autre chose. Les modes d’existence entrent en collision. Cette société multiculturelle risque d’être beaucoup plus violente que la nation qu’elle vise à remplacer.
Comment tenir ce discours sans être traité de réactionnaire ou de fasciste ?
Il me semble que c’est une folie de vouloir criminaliser l’appartenance à un peuple ou à une nation. Cette folie fait le jeu, en France, du Front national. L’inquiétude identitaire doit être prise en compte par les partis républicains, la gauche notamment parce qu’elle touche le peuple. Si celle-ci veut continuer à être hospitalière, elle doit concevoir l’hospitalité comme le fait de donner ce qu’on a et non selon la doctrine en vogue, celle de l’effacement ou de l’oblation de soi afin de permettre à l’Autre d’être pleinement ce qu’il est.
En complément
Extrait d’un entretien paru dans le magazine Nouvelles d’Arménie n°202 (décembre 2013) :
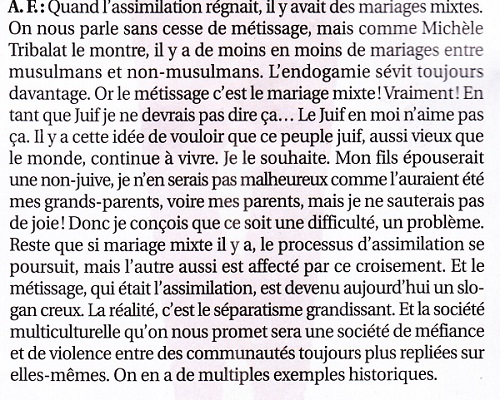













 et
et  !
!