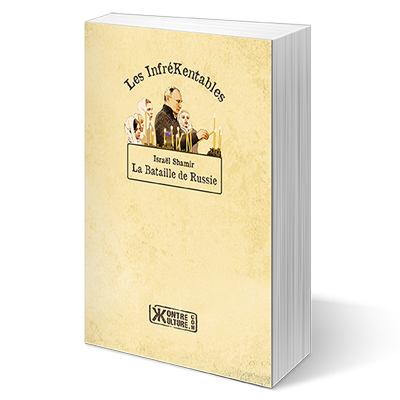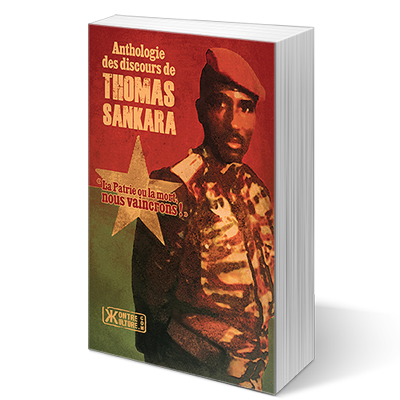Nous assistons à une restauration conservatrice en Amérique latine. Afin de comprendre les mécanismes à l’origine de ce processus, je rappelle le déroulement des coups d’État depuis celui au Venezuela en 2002 (au Honduras, en Paraguay, au Brésil), les coups ratés (en Équateur et en Bolivie). On peut observer comment les droites continentales travaillent à discréditer les gouvernements progressistes afin de créer les conditions pour réaliser des golpes d’un genre nouveau ou pour préparer des retournements électoraux comme ce fut le cas au Venezuela et en Argentine en novembre-décembre 2015.
Les années 80 et 90 avaient été marquées pour l’Amérique latine par deux mouvements contradictoires : le retour des gouvernements civils au terme de dictatures féroces et l’adoption généralisée de politiques néolibérales. Les gouvernements civils pratiquaient une démocratie de « basse intensité » limitée à des scrutins ouverts pendant qu’ils procédaient à des privatisations en cascade, qu’ils s’attaquaient aux programme sociaux au nom de l’austérité budgétaire et qu’ils s’engageaient dans des accords de libre-échange. Ces politiques néolibérales s’inscrivaient dans le « consensus de Washington », lequel établissait une équation entre libéralisme économique, démocratie, droits de la personne et mondialisation. Mais elles avaient un coût énorme pour les majorités. Aussi ont-elles secrété leur antidote : la montée des mouvements sociaux.
À partir de 1998, à commencer par le Venezuela, mais à la façon d’une vague déferlante, des gouvernements progressistes conquièrent le pouvoir en lien avec des mouvements sociaux et redessinent la carte géopolitique de la région en impulsant de nouvelles politiques publiques axées sur l’incorporation de secteurs jusque-là marginaux par le biais de programmes sociaux. Parallèlement, ils s’engagent dans une intégration continentale solidaire contraire aux ambitions hégémoniques des États-Unis.
Chassée du pouvoir dans plusieurs pays, la droite n’allait pas encaisser le coup sans réagir. Tout en se battant pour conserver le pouvoir dans plusieurs autres pays, elle engageait le combat contre les gouvernements progressistes. Elle allait mener une guerre économique par le biais des sociétés qu’elle contrôle : on assistera à des grèves patronales, aux désinvestissements, à l’évasion fiscale, à des pénuries, à des sabotages. Ces tactiques s’intègrent à une guerre idéologique menée par les médias qu’elle possède et qui vise à semer la confusion, à apeurer les secteurs moyens, à attiser les ressentiments des uns contre les autres, à faire naître des mouvements de protestation bâtis sur les rumeurs de corruption et de narcotrafic au sein des gouvernements progressistes. La droite développe la guerre psychologique. L’objectif est de préparer le terrain pour une récupération du pouvoir par les urnes ou autrement.
Notre exposé va se concentrer sur ces autres façons de reprendre le pouvoir. Nous allons passer en revue ces situations qui empruntent la voie du coup d’État (golpe). Ces golpes obéissent à une nouvelle scénarisation. Ils ne sont plus menés par un état-major et ils ne débouchent plus sur des gouvernements militaires. Voilà la nouveauté. À la différence des années 60 et 70, la droite entend désormais gouverner sans intermédiaire.
1. Reconquérir le Venezuela en sortant Chávez
L’histoire débute au Venezuela. Depuis janvier 1999, Hugo Chávez, fort de sa victoire aux urnes en décembre 1998, a entrepris une transformation profonde. Une nouvelle constitution adoptée en décembre entend refonder la démocratie mise à mal par la corruption et le clientélisme pratiqués par les gouvernements issus du pacte de Punta Fijo en 1958. Plusieurs élections viennent confirmer la légitimité de la « révolution bolivarienne » en marche. Le nouveau Venezuela aspire à une démocratie participative fondée sur une redistribution équitable de la manne pétrolière. Il se heurte au Venezuela des nantis et de ces secteurs moyens aliénés qui ont les pieds à Caracas et la tête à Miami. À partir de décembre 2001, l’opposition réunie dans la « Coordination démocratique » organise des protestations à répétition pour exiger la démission du président Hugo Chávez ou à tout le moins un référendum en vue de sa destitution. Le 11 avril 2002, une manifestation, orchestrée par des partis politiques, l’élite économique et les médias, dégénère en un affrontement au cours duquel des manifestants (15) sont tués. Le lendemain, un groupe de militaires vénézuéliens s’empare du président Hugo Chávez et le transfère dans un poste militaire. Peu après, après avoir annoncé que Chávez avait signé une lettre de démission, un groupe civilo-militaire forme un gouvernement dirigé par le chef d’une association patronale et annonce tout de go qu’il va défaire ce que la Révolution bolivarienne a construit. Washington s’empresse de saluer le changement de gouvernement et de lui donner une caution démocratique, une interprétation que d’autres pays d’Amérique latine refusent d’avaliser. En l’espace de quelques heures, des manifestants venus des ceintures populaires de Caracas déferlent sur le centre-ville, provoquant un retournement de la situation, le retour de Chávez au Palais présidentiel et la dispersion de ceux qui prétendaient constituer le nouveau gouvernement.
Le Venezuela venait de vivre un coup d’État raté. Un coup d’État que ses auteurs ne voulaient pas reconnaître comme tel. Aussi avaient-ils inventé ce simulacre d’une démission de Chávez. L’autre nouveauté était que les militaires n’avaient été qu’un moment et qu’un partenaire dans une opération dirigée par et au profit d’une opposition civile qui regroupait des nantis, des organisations patronales, les grands médias, l’Église. Les putschistes avaient fabriqué l’incident déclencheur : le massacre. On devait découvrir que les victimes du 11 avril avaient été abattues par des tireurs embusqués qui n’avaient rien à voir avec les chavistes. Et que les États-Unis avaient été partie prenante du complot visant à virer un régime qu’il ne pouvait contrôler dans ce qu’ils considéraient leur « arrière-cour ».
Ce ne sera pas le dernier coup d’État. Mais les suivants se donneront encore plus de mal pour camoufler leur nature et pour faire croire que le changement de gouvernement est en accord avec les institutions, avec la constitution, en somme qu’il s’inscrit dans la légalité. Ce sera le cas pour le Honduras en 2009, pour le Paraguay en 2012 et pour le Brésil en 2016.
2. Conserver le Honduras : non à la constituante
Le 28 juin 2009, des militaires honduriens arrêtaient le président Manuel Zelaya et le détenaient sur une base aérienne avant de l’expulser au Costa Rica. Ici encore les putschistes prétendirent que Zelaya avait signé une lettre de démission. Roberto Micheletti, le président du Congrès, fut désigné chef du gouvernement. Or il se trouve que la lettre livrée pour preuve était datée du 25 juin. Tous les pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire) s’entendirent pour faire de la destitution de Zelaya et de la désignation de Micheletti une « succession constitutionnelle ». Tous ont invoqué la constitution et les lois du Honduras pour justifier leurs actions en accusant Zelaya, sans procès, de les avoir violées. Des juristes indépendants ont pourtant conclu que le Congrès avait outrepassé ses prérogatives en démettant le président. Le gouvernement Micheletti a par la suite multiplié les décrets qui démontraient son total mépris de la légalité dans laquelle il se drapait.
L’oligarchie était le véritable instigateur du coup d’État. Cette oligarchie ne se reconnaissait plus dans Zelaya, un industriel forestier devenu politicien après avoir présidé des organisations patronales. Élu à la présidence en 2005, sous la bannière libérale, celui qu’on surnomme « Mel » s’employait à réaliser sa promesse d’ouvrir le pouvoir à la participation citoyenne, s’appuyant de plus en plus sur les mouvements sociaux. Zelaya était vu comme un traître à sa classe puisqu’il collaborait avec des gens de gauche. N’avait-il pas entraîné le Honduras à adhérer à l’ALBA (Alliance bolivarienne pour les Amériques), cette alliance progressiste opposée au libre-échange et à l’hégémonie états-unienne ?
Mais la principale faute de Zelaya avait été d’organiser une consultation en ce 28 juin sur l’opportunité d’ajouter une quatrième urne lors des élections générales du 29 novembre. Zelaya voulait sonder ses concitoyens sur leur intérêt pour la convocation d’une assemblée constituante, une demande des organisations populaires, syndicales, autochtones. Instruites des opérations de même nature menées au Venezuela, en Bolivie, en Équateur, les élites y ont vu un engrenage menant à un réel partage du pouvoir dont elles feraient évidemment les frais dans ce pays le plus pauvre d’Amérique centrale. Les auteurs du coup d’État entendaient bloquer l’émergence d’un mouvement social de plus en plus revendicatif, enhardi par ses victoires arrachées dans des luttes auxquelles Zelaya avait choisi de ne pas s’opposer, décidant plutôt de les accompagner, y trouvant même sa mission.
La société civile se mobilisa contre le coup d’État, mais se heurta à une répression mortelle. Les militaires appliquèrent avec zèle et brutalité les différentes mesures adoptées par le régime de facto : couvre-feu, état de siège, interventions auprès des médias de l’opposition, etc. Presque tous les pays d’Amérique latine dénoncèrent le coup d’État et imposèrent des sanctions. Rien n’y fit. La restauration de Zelaya fut impossible. Les élections du 29 novembre 2009, contrôlées par les putschistes, furent une mascarade cynique. Que les États-Unis en aient reconnu la validité à l’avance, sans égard au contexte local et continental, démontre un cynisme et un mépris sans pareils. Les agissements des États-Unis en catimini, par le biais d’États-clients (particulièrement le Costa Rica d’Óscar Arias, mais aussi le Panama et le Pérou), révèlent que la logique impériale persiste en dépit des discours du président Obama : faire obstacle à tout changement qui remet en question leurs ambitions hégémoniques en jouant des divisions, des rivalités entre les États et en exploitant les contradictions internes. Il ne faut pas perdre de vue que le Honduras est, avec la base de Soto Cano (Palmerola), une pièce maîtresse du dispositif états-unien d’intervention dans la région.
Sept ans plus tard, le Honduras demeure un État en déliquescence. Avec un taux d’homicides de 68 pour 100 000 (2014), il est le pays le plus violent de la planète. Les assassinats politiques sont monnaie courante, ciblant les militants, les indigènes, les journalistes : la leader écologiste Berta Cáceres figure parmi les victimes. La corruption y est endémique. Le débat actuel concerne la réélection. Le président Juan Orlando Hernández, un imposteur élu grâce à la fraude en 2013, aspire à un second mandat en 2017, ce qu’interdit l’article 239 de la Constitution de 1982. Or une section de la Cour suprême a récemment déclaré cet article inconstitutionnel. L’opposition avait dénoncé cette interprétation qui ouvrait la voie à un « coup d’État permanent ». Aujourd’hui le mouvement issu de la résistance au coup d’État révise sa position, envisageant de s’unifier autour de la candidature de Manuel Zelaya qui jouit d’une énorme popularité. C’est comme si l’histoire bégayait.
3.Pas de réforme agraire au Paraguay
Une autre destitution allait braquer, pendant un court moment, le regard médiatique sur le Paraguay. Le 22 juin 2012, au terme d’un « procès politique » expéditif, en alléguant cinq motifs, mais sans fournir aucune preuve, le Congrès destituait le président Fernando Lugo et le remplaçait par le vice-président Francisco Franco. Nombre d’observateurs informés ont alors parlé d’un « coup d’État parlementaire ». L’émotion a été grande en Amérique latine, particulièrement chez les pays voisins, entraînant la suspension du Paraguay d’organisations régionales (Mercosur, Unasur, CÉLAC).
Lire la suite de l’article sur mondialisation.ca
À ne pas manquer à la rentrée, le coffret « Hugo Chávez »
chez Kontre Kulture :
Ce coffret comportera un documentaire réalisé en partie au Venezuela lors des obsèques d’Hugo Chávez, ainsi que deux ouvrages écrits par Vincent Lapierre : une anthologie de discours ainsi qu’une biographie, très probablement la seule et la plus complète biographie d’Hugo Chávez en langue française.
Les souscripteurs qui ont, avec patience, soutenu la réalisation du documentaire, recevront prochainement par voie postale le DVD et le livre des discours qui sont en cours d’impression.
Il est à noter que le documentaire, se voulant aussi complet que le livre dont il est issu, durera plus de 3 heures ! Sa réalisation en est d’autant plus longue, mais c’est le prix à payer pour offrir un véritable document exhaustif sur l’histoire du Venezuela, la naissance, la jeunesse et la formation d’Hugo Chávez, sa prise de pouvoir, sa présidence puis sa mort.
Dès lors, le boitier DVD qui sera livré avec l’anthologie des discours ne comportera pour le moment que la première partie (histoire du Venezuela et l’ensemble de la vie d’Hugo Chávez jusqu’à son accès à la présidence). Bien entendu, dès que la 2ème partie (la présidence, la mort, les funérailles et l’héritage) du documentaire sera terminée, celle-ci sera envoyée gracieusement aux souscripteurs qui pourront ranger le deuxième DVD dans le boitier, à côté du premier.
La mise en vente se fera prochainement sur notre site partenaire Kontre Kulture. Un article sur le site Égalité & Réconciliation préviendra nos lecteurs.

S’inspirer des dirigeants non-alignés avec Kontre Kulture













 et
et  !
!