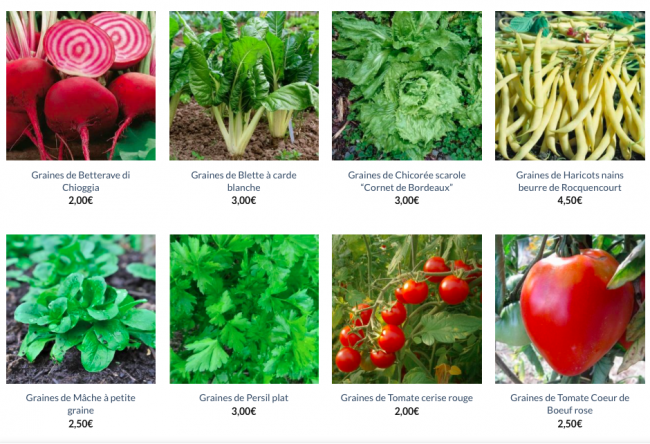Présentation de l’auteur :
Né en 1975, originaire d’une région de grande culture dans laquelle on trouvait encore quelques fermes d’élevage et déjà quelques marginaux s’essayant à l’agriculture biologique, Cédric découvre le développement des végétaux et les rythmes naturels du vivant dans le jardin familial.
Ses premières expériences professionnelles concernent les jardins urbains, la végétalisation des toits à Paris. Puis, dans le sud, c’est d’abord la production horticole conventionnelle qui l’occupe, avant de s’orienter vers le maraîchage biologique, à travers une formation spécifique et plusieurs saisons chez un maraîcher bio expérimenté. Après un stage chez un producteur de graines et la découverte du réseau Semences paysannes, Cédric s’installe en 2005 dans les Cévennes, sur de vieilles terres agricoles abandonnées, dont il restaure les terrasses oubliées, y développant vergers, jardins vivriers et de graines.
« Permaculture, terme à la mode, créé dans les années 70. Je souhaite synthétiser ici les bases techniques et profondément subversives que recèle ce mot-valise. »
Contextualisons !
L’agriculture dite « conventionnelle » et ultraproductive s’est généralisée durant la deuxième moitié du XXe siècle dans les pays développés. En France, par exemple, le rendement moyen du blé est passé, en hausse constante, d’environ 11 quintaux par hectare et par an (pour la période 1815-1945) à 70 quintaux par hectare à partir des années 1980. À noter que depuis plus de 30 ans, ce chiffre stagne.
La science technologique contemporaine a permis cela en gagnant tous les niveaux de la production agricole : amélioration variétale (sélection, hybride F1, champs de clones, et tout ce que permet le génie génétique), mécanique de précision (pour les semis, désherbages, récoltes, tris), chimie de synthèse (engrais, fongicides, acaricides, insecticides, « mammifèricides », herbicides).
Arrivé ici, précisons que les qualités nutritives et sanitaires des produits alimentaires issus de ces pratiques ne sont que peu prises en compte, voire pas du tout, par les instances agricoles, commerciales et de santé publique officielles.
Ainsi, dans cette agriculture, le sol n’est qu’un substrat inerte sur lequel on fait se succéder des végétaux. Une fois la récolte faite, on nettoie (exportation des résidus de culture), on travaille le sol et on ressème. À ce moment du cycle cultural apparaît un problème essentiel : la terre est mise à nu (ce qui n’arrive normalement pas dans la nature sous nos climats tempérés, le sol restant constamment couvert) et va se voir agressée fortement, et en premier lieu sa couche superficielle (la plus fertile normalement), celle qui provient d’une décomposition récente, où les minéraux n’ont pas encore été lessivés par la pluie (terre de couleur noire, terre de jardin, humus, sol forestier, compost). Tout d’abord, le sol va subir l’ensoleillement direct ; et en plein été, les premiers centimètres peuvent littéralement cuire. Lors de fortes pluies, cette même couche superficielle, la plus fertile, est emportée, allant parfois jusqu’à creuser les champs d’ornières de plus de 50 cm de profondeur.
Face à cette érosion dramatique, aux problèmes de maladies, de ravageurs (induits ou non, et souvent persistants malgré les traitements chimiques), et compte tenu des coûts réels de ces techniques de production, une autre solution est réapparue un peu partout sur la planète depuis environ un siècle, et c’est elle qui se trouve cachée dans la mallette permacole.
En France, un développement naissant
Commençons par la France, même si cette redécouverte n’y est que tardive.
En 1971, Jacques Monod, nouveau directeur de l’institut Pasteur, décide d’en supprimer le laboratoire de microbiologie des sols. Trois professeurs proches de la retraite se retrouvent alors à enseigner à l’Institut national agronomique Paris-Grignon.
Claude Bourguignon, jeune étudiant, a alors 20 ans. Passionné par le vivant, il se retrouve en cours particuliers avec les détenteurs d’une connaissance agronomique essentielle, dans un établissement dédié, quant à lui, au « progrès ».
Il y apprend, grâce à ces trois professeurs, ce que sont les bactéries, les champignons et la mésofaune, qu’abritent certains sols, qui apportent aux plantes les nutriments nécessaires à leur croissance et à leur développement. Ainsi, les vers de terre produisent de l’azote assimilable par les plantes, les mycorhizes en symbiose avec les racines leur apportent (entre autre) du phosphore, et certaines bactéries, du soufre… Tout ceci dépendant d’une matière fraîche, c’est-à-dire d’une décomposition récente.
Plus tard, Claude Bourguignon intégrera le seul labo de l’INRA (Institut national de la recherche agronomique) acceptant les recherches en ces domaines. Il y rencontrera Lydia, sa future femme, spécialiste quant à elle des qualités nutritives des végétaux.
Devant le désintérêt de leur hiérarchie pour leurs analyses (qui concluent à la disparition de l’activité biologique des sols cultivés, et à la perte de ces sols par érosion), il décide avec sa femme, en 1989, de créer leur entreprise : le Laboratoire d’analyse microbiologique des sols (LAMS).
Tous deux militent depuis pour ce qu’ils appellent l’« agroécologie », en rappelant notamment que l’agriculture actuelle perd, par ravinement, 10 tonnes de sol fertile à l’hectare par an. L’agroécologie se base donc sur le non-travail du sol et la couverture permanente de celui-ci, sur la présence de haies en bordure des champs, sur une symbiose entre le sauvage, l’élevage, les cultivateurs...
Aux racines du concept
Revenons au personnage de référence de la permaculture : Masanobu Fukuoka (1913-2008), il semble être, selon les permaculteurs, le premier à mettre en pratique les solutions précédemment citées.
Cet étudiant en maladie des plantes, également formé à la biologie des sols, travaille dans un premier temps aux services sanitaires des douanes nippones. Il décide ensuite de se consacrer à la reprise en main des terres de son père. Il y développera les bases d’une agriculture simple et naturelle : concrètement, il va semer son riz, ou son seigle (suivant la saison), dans les restes de la culture précédente (résidus de fauche, ainsi que le système racinaire déjà en place). Les travaux agricoles se résument donc ici à : fauche, récolte du grain, remise au sol des pailles, semis.
Les avantages de ce processus sont :
![]() il n’y a pas de remontée de graines concurrentes par le labour, ce qui met la graine semée en première position ;
il n’y a pas de remontée de graines concurrentes par le labour, ce qui met la graine semée en première position ;
![]() à l’ombre des chaumes, une humidité propice à la germination est maintenue.
à l’ombre des chaumes, une humidité propice à la germination est maintenue.
En se décomposant, comme nous l’avons vu, cette matière rendra lentement mais directement au sol les éléments qu’elle y a pris.
Fukuoka obtiendra ainsi des rendements équivalents à ses voisins qui cultivaient en conventionnel ; il sera reconnu dans de nombreux pays dès les années 1980.
Une agriculture « de conservation » en Amérique du Nord
Mais en faisant des recherches sur Internet, j’ai découvert qu’une agriculture que l’on nomme ici « de conservation » s’était déjà développée dans les grandes plaines céréalières d’Amérique du Nord dès 1930, à la suite de phénomènes d’érosion éolienne et hydrique.
Ses trois piliers sont :
![]() perturbation minimale du sol (l’action se résume à une ligne de semis sur 2-5 cm de profondeur) ;
perturbation minimale du sol (l’action se résume à une ligne de semis sur 2-5 cm de profondeur) ;
![]() restitution des résidus de culture ;
restitution des résidus de culture ;
![]() rotation culturale diversifiée.
rotation culturale diversifiée.
Les Brésiliens et Argentins ont quant à eux débuté le semis direct dans les années 70, faisant passer ces pratiques de 100 000 hectares cultivés à 14 millions en 20 ans, le climat tropical et ses fortes pluies obligeant plus impérativement les paysans à trouver des solutions alternatives à l’agriculture conventionnelle, celle du labour.
Au sein du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (né en 1984 de la fusion des différents instituts de développement agricole liés aux territoires d’outre-mer), une « unité propre », entre autre représentée par Lucien Seguy et Serge Bouzinac, participe à ce succès et travaille à son importation en France.
À ce jour, environ 70 millions d’hectares dans le monde sont cultivés en semis direct avec une baisse des besoins en produits phytosanitaires, en engrais chimiques et en pétrole.
Des écueils à éviter
Voilà, à mon sens, le mouvement de fond sur lequel surfent les permaculteurs et le risque de noyade qu’ils prennent en oubliant d’en comprendre les principes fondateurs simples.
Ainsi, par exemple, prenant comme référence « l’écosystème forêt », capable de produire spontanément une grande quantité de biomasse (énergie bois en l’occurrence) grâce à un sol fertile, des permaculteurs en viennent à imaginer des potagers sous des arbres fruitiers et ainsi multiplier les rendements sur une même surface. Ils oublient qu’alors les plantes cultivées au-dessous souffriront d’un manque évident de lumière (cela peut être toutefois possible pour les premières années d’un verger). Il faut de plus s’adapter à son climat : ce qui est possible dans la région de Perpignan ne l’est peut-être pas près de Dunkerque…
Ou encore d’autres, s’appropriant un peu vite la « culture sur butte » au départ réservée aux terres incultes, vont concentrer toute la matière qui traîne aux alentours en un tas magique aux productions gargantuesques, du moins l’espèrent-ils. Les rendements que j’ai observés sur YouTube ne paraissent pas justifier cette mise en œuvre conséquente.
Je passe sur les autres velléités permacoles, comme celle d’appliquer l’astrologie au jour près pour déterminer l’agenda des travaux des champs (compliqué dans le temps et avec la météo) ou encore le souhait de faire des jardins en spirales (compliqué dans l’espace !).
Je me souviens, dans la même veine, d’une vidéo ou un spécialiste permacole affirmait nourrir facilement sa famille avec un potager de 300 m2, mais sans aucune photo ou aucun relevé de production. Et d’un ton condescendant railler ceux qui voulaient produire des pastèques parce que lui, cultivait des Mélotries (melothria scabra), d’après ses dires bien plus productives, mais sans préciser que les fruits ne font pas plus de 5 cm de long…
Pour revenir sur l’engouement pour l’agroforesterie, je pense que des haies arbustives en périphérie des champs, ou quelques arbres sur des parcelles de plusieurs hectares ont des effets bénéfiques sur les cultures : limitation de l’impact du vent qui peut freiner la croissance des végétaux, accueil des auxiliaires qui régulent la population des ravageurs (par exemple coccinelles contre pucerons). Mais sans suffisamment de soleil direct, le végétal … végète : comme le cœur fait circuler le sang et ses nutriments dans le corps, l’évaporation à la surface des feuilles pompe et distribue la sève et ses nutriments dans la plante. La photosynthèse, d’une autre manière, mais également grâce à l’action du soleil sur les feuilles, synthétise les matières organiques en absorbant du gaz carbonique.
Il est intéressant de noter que c’est à l’orée des bois, ou au sein d’une clairière, qu’apparaissent spontanément les plantes de la fructueuse famille des rosacées (pommes, prunes, poires, fraises, framboises, mûres…). Elles y trouvent un sous-sol forestier fertile qui leur permet de dépenser une énergie conséquente à la formation d’une enveloppe charnue et sucrée destinée à séduire potentiellement le mammifère qui passerait aux alentours ; mais aussi l’ensoleillement suffisant : sans assez de soleil, peu de fruits et peu de goût.
Conclusion
Au regard de tous ces éléments, le semis direct (sans travail du sol) sous couvert végétal (résidus de cultures précédentes, engrais vert, bois raméal fragmenté (BRF), feuilles d’arbres, tontes de gazon…) me semble être la technique fondamentale si on raisonne en terme d’autofertilité du sol (avec un apport de matière, en plus des semis), sans dépendance à l’industrie pétrochimique. Évidemment, il faut compter avec une main-d’œuvre plus conséquente, qualifiée et motivée. De plus, comme aucune solution n’est parfaite (ou prête à s’accomplir), l’inconvénient majeur à prendre en compte est que les techniques de couverture du sol peuvent ralentir son réchauffement printanier, et par conséquent, la germination des graines.













 et
et  !
!