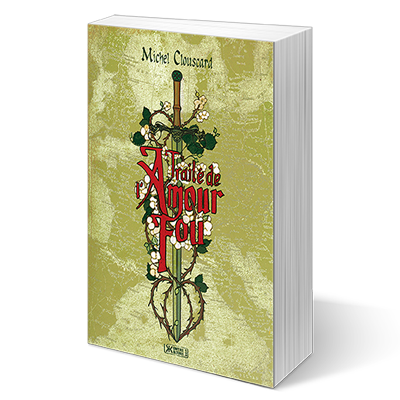« L’amour est le miracle de la civilisation », a écrit Stendhal dans son essai De l’amour. C’est pourquoi il diffère d’une civilisation à l’autre, et d’une époque à l’autre.
On a toutes les raisons de se lamenter sur les modèles et les idées dominantes qui conditionnent l’expérience amoureuse des garçons et des filles aujourd’hui : négation de l’altérité des genres, exacerbation de la pulsion sexuelle… Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, encore faut-il savoir d’où nous venons, c’est-à-dire réfléchir sur l’imaginaire et l’éthique de la passion amoureuse élaborés par la civilisation occidentale, depuis la courtoisie médiévale jusqu’au romantisme du 19e siècle. Il existe à ce sujet des jugements contradictoires, liées à l’opposition entre l’éros et l’institution du mariage. Mais ce qui est très généralement incompris, et qui pourtant est l’une des clés de notre civilisation, c’est l’origine religieuse de cette tradition que nous nommerons « romantisme » et qui constitue, pour reprendre les termes de Denis de Rougemont (L’Amour et l’Occident) « l’un des pôles de notre tension créatrice ». Le christianisme et le romantisme se partagent l’esprit et le cœur de l’Occident.
Vérité du romantisme
Au sens de l’histoire culturelle, le romantisme est un mouvement artistique européen né à la fin du 18e siècle, qui a des contours imprécis et des formes diverses selon les pays. Il exalte la beauté de la nature et a nourri les sentiments nationalistes par sa valorisation des mythologies celtiques et germaniques. Aujourd’hui, on nomme vulgairement « romantique » une certaine idée de la passion amoureuse, et c’est effectivement un thème central du romantisme depuis ses premières manifestations poétiques. Je ne parle pas ici des formes dégradées du romantisme, par Hollywood en particulier.
C’est chez le poète allemand Novalis (1772-1801) que le terme « romantisme » apparaît pour la première fois. Et c’est dans sa vie et son œuvre que se manifeste le plus nettement la définition que je propose : le romantisme est une conception héroïque de l’amour. Pour le comprendre, citons sans tarder le passage des ses Hymnes à la nuit où Novalis évoque le deuil de sa jeune fiancée Sophie von Kühn, qui a bouleversé son âme et déclenché sa vocation poétique.
« Un jour je répandais des larmes amères ; la douleur avait dissipé mon espérance, et j’étais seul auprès de ce tombeau sombre qui cache tout ce qui faisait la force de ma vie ; seul, comme personne ne pouvait l’être, sans appui et n’ayant plus qu’une pensée de malheur ; j’appelais du secours sans pouvoir aller ni en avant, ni en arrière, et je m’attachais avec ardeur à cet être que j’avais vu mourir. Alors des lointains bleuâtres, des lieux témoins de mon ancienne félicité, un doux rayon vint à poindre ; la pompe terrestre s’enfuit, et avec elle ma tristesse ; je m’élançai dans un monde nouveau, immense, tu descendis sur moi, inspiration de la nuit, sommeil du ciel ; la contrée s’éleva peu à peu, et sur la contrée planait mon esprit dégagé de ses liens. Le tombeau près duquel j’étais assis, m’apparut comme un nuage, et à travers ce nuage j’aperçus les traits rayonnants de ma bien-aimée. L’éternité reposait dans ses yeux, je pris ses mains, et mes larmes coulèrent en abondance. Les siècles s’en allèrent au loin comme un orage, tandis que, suspendu à son cou, je versais des pleurs délicieux. Ce fut là mon premier rêve, et depuis j’ai senti dans mon cœur une foi constante et inaltérable au ciel de nuit, et à ma bien-aimée, qui en est la lumière. »
On voit tout de suite en quoi le romantisme est héroïque et donc religieux. Au sens grec classique, ce qui fait le « héros » est la mort prématurée, tragique et sacrificielle, et le culte par lequel une communauté préserve sa mémoire ; ce sont ces deux choses qui produisent l’immortalité. Dans la poésie épique ou dans la tragédie grecque, il est surtout question de l’immortalité du mort dans la mémoire des vivants. Mais dans les mythes et dans les contes populaires qui en dérivent, l’immortalité est narrée comme un accès ou un voyage du héros dans l’Autre Monde bienheureux.
Dans la poésie romantique, l’amour accède à l’absolu et à l’immortalité par la mort. En ce sens, le romantisme est fondamentalement religieux, tout comme l’imaginaire héroïque antique « J’ai pour Sophie de la religion, non de l’amour », écrit Novalis dans ses Fragments. C’est par cette religiosité que le romantisme s’oppose au rationalisme des Lumières (mais pas à Rousseau, en qui il reconnaît au contraire un précurseur, avec Julie ou la Nouvelle Héloïse). Et c’est aussi, paradoxalement, cette religiosité que lui reprochèrent ses adversaires catholiques, en y voyant une émanation du protestantisme allemand. En réalité, les romantiques allemands ne furent pas directement influencés par le protestantisme, mais plutôt par des courants hétérodoxes comme l’illuminisme de Jacob Böhme (1575-1624) ou l’idéalisme de Schelling (1775-1854).
Le romantisme anglais, quant à lui, conserve l’empreinte de Shakespeare, dont l’œuvre emblématique Roméo et Juliette peut-être considérée comme le mythe parfait de l’amour, dépassant avantageusement le drame inachevé de Tristan et Iseut par un dénouement christique : le double suicide des amants acquiert la portée d’un sacrifice rédempteur, lorsque les Capulet et les Montaigu se repentent de leur vendetta et s’engagent à élever en l’honneur de leurs enfants des statues dorées côte à côte dans la ville de Vérone désormais pacifiée.
Sans surprise, dans son étude sur Shakespeare, René Girard, l’auteur du célèbre essai Mensonge romantique et vérité romanesque, ne consacre qu’une seule page à Roméo et Juliette, pour en dénoncer le « dénouement tiré par les cheveux » et le « cynisme avec lequel la crédulité romantique y est exploitée ». Girard prouve ainsi que ce qu’il prend pour le « mensonge romantique » est une vérité qui le dépasse. Le romantisme ne ment pas ; simplement, sa vérité n’est pas de ce monde. L’amour qu’il célèbre est une force en lutte contre l’ordre social, non pas parce qu’il est trop pulsionnel, mais au contraire parce qu’il est spirituel. L’amour héroïque aspire à la permanence, mais il vit dans l’instabilité ; il se nourrit de l’obstacle et de la distance. C’est pourquoi les grands textes mythiques de l’amour héroïque soulignent que la passion amoureuse, si elle donne à la vie terrestre un goût de paradis, présente une inquiétante attirance pour la mort.

Pour la même raison, l’amour héroïque est souvent conçu comme incompatible avec le mariage, tout comme l’était déjà la fin’amor des troubadours dont je parlerai plus loin. Cette opposition renvoie à un dilemme existentiel que Kierkegaard a vécu et formulé en ces termes :
« Par la femme l’idéalité entre dans la vie, et sans elle que serait l’homme ? Maint homme est devenu un génie grâce à une jeune fille, maint homme est devenu héros grâce à une jeune fille, maint homme est devenu poète grâce à une jeune fille ; mais aucun d’eux ne devint génie grâce à la jeune fille dont il obtint la main, car grâce à elle il ne devint que Conseiller d’État ; aucun ne devint héros grâce à la jeune fille dont il obtint la main, car grâce à elle il ne devint que général ; aucun ne devint poète grâce à la jeune fille dont il obtint la main, car grâce à elle il ne devint que père ; aucun ne devint saint grâce à la jeune fille dont il obtint la main, car il n’en obtint aucune et il n’en désira qu’une seule, qu’il n’obtint pas, de même que chacun des autres devinrent génie, héros et poète grâce à la jeune fille dont il n’obtint pas la main. »
Est-ce là simplement la vision pessimiste d’un homme qui a renoncé à épouser la jeune fille qu’il aimait (Régine Olsen) pour cultiver son génie ? Quoiqu’il en soit, c’est pour Kierkegaard un paradoxe fondamental, sur lequel il reviendra souvent : « À l’un, Dieu donne la femme qu’il aime, mais elle a gâté l’Idée ; à l’autre, Dieu refuse l’aimée, mais lui laisse intacte l’Idée » (Journal). Les fruits intellectuels ou spirituels de l’amour ne mûrissent que dans la souffrance de l’amour déçu. L’homme marié répondra, naturellement, que les fruits du mariage réussi, des enfants bien élevés, sont un don au monde tout aussi précieux que les œuvres intellectuelles. Il faut bien des parents pour mettre au monde les génies.
Mais il y a au moins dans la théorie de Kierkegaard une vérité anthropologique importante : l’éveil du sentiment amoureux chez le garçon est un état de grâce mêlé de tourment qui fait éclore l’individualité et marque la personnalité d’une empreinte indélébile. Par conséquent, qui détruit l’image de la femme chez l’adolescent fabrique des hommes sans idéalité. Malheur à l’enfant dont l’imaginaire amoureux a été dévoré par la pornographie !
Naissance de l’amour courtois
Toute société fabrique un certain idéal de la féminité, de la virilité et de leur complémentarité. Cet idéal nourrit l’imaginaire et prédispose l’expérience amoureuse des enfants. Le garçon voit la fille à travers le filtre de sa culture (et inversement), et par culture il faut entendre tout ce qui relève de la transmission, y compris les codes sociaux, la mode, la danse (surtout la danse)… Comme toute expérience humaine, l’amour n’est ni exclusivement « naturel », ni exclusivement « culturel », mais les deux à la fois. La façon de concevoir et de vivre sa masculinité ou sa féminité se construit dans la distance et le rapport à l’autre sexe, qui sont en partie culturellement structurés, bien que biologiquement déterminés.
Lorsqu’on s’interroge sur les conditionnements culturels de la passion amoureuse en Occident, on en fait souvent remonter l’origine à l’ « amour courtois », expression moderne pour désigner une tradition aristocratique formalisée d’abord dans la poésie occitane du 12e siècle. Cette poésie et son idéologie sous-jacente s’épanouissent d’abord en Aquitaine, d’où la duchesse Aliénor (1122-1204), petite-fille du premier troubadour, l’introduira à la cour de son premier mari, roi de France, puis à celle de son second mari, roi d’Angleterre. La fin’amor (amour raffiné) des troubadours cultive l’ascèse du désir, et se présente comme une voie de développement spirituel pour l’homme. « Prenez ma vie en hommage, belle de dure merci, pourvu que vous m’accordiez que par vous au ciel je tende ! » écrit le troubadour Uc de Saint-Circ (1213-1257). « Chaque jour je m’améliore et me purifie, car je sers et révère la plus gente dame du monde », écrit Arnaut Daniel (1150-1210). Dans l’idéal chevaleresque, l’amour de la dame augmente la vaillance et la noblesse du caractère.
L’amour courtois constitue une dimension essentielle des romans en vers composés dans le Nord de la France entre le 12e et le 13e siècle, dont Chrétien de Troyes est le maître incontesté. Ses romans entrecroisent plusieurs sens symboliques. Dans Érec et Énide, par exemple, l’aventure centrale se déroule dans une île qui a tous les attributs du Paradis. Dans un jardin merveilleux, Érec découvre une très désirable demoiselle, qui se révélera être la cousine d’Énide. Il doit alors affronter un terrible chevalier rouge. À l’issue d’un long combat, celui-ci s’avoue vaincu, mais déclare se trouver du même coup libéré, car il était en réalité prisonnier de sa belle. Érec peut alors célébrer avec Énide et tous les habitants de l’île « la Joie de la Cour » (La Joie del Cort). Lorsqu’on connaît les codes de Chrétien de Troyes, qui joue sur les mots et dédouble ses personnages (en frères ou cousins), on comprend que, non seulement les deux femmes n’en font qu’une, mais que le chevalier rouge est aussi le double d’Érec, son côté obscure, pulsionnel. C’est donc contre lui-même que se bat Érec, et c’est en maîtrisant ses pulsions qu’il atteint la « Joie du Cœur » avec Énide.
Les romans et lais (poèmes plus courts) en ancien français n’ont pas pour seule inspiration la poésie occitane. Ils puisent également dans la riche tradition « bretonne » (c’est-à-dire galloise), très prisée à la cour anglo-normande des Plantagenêt. Le roman composite de Tristan et Iseut est l’un des fruits de cette rencontre, qui compte aussi les « lais bretons » de Marie de France. L’un des thèmes favoris de cette tradition narrative, à laquelle se rattachent nombre de romans comme ceux de Mélusine, La Manekine ou Le Bel Inconnu, est la passion amoureuse d’un mortel pour une femme surnaturelle, qui s’apparente à une jeune revenante cherchant à accomplir le destin nuptial dont l’a privée une mort tragique (thème des « noces funèbres ») ou qui, dans les versions qui ont inspiré à Andersen « la petite sirène », acquiert une âme en s’unissant à un mortel. Cette lecture de la tradition mytho-poétique celte permet de saisir l’essence religieuse de cette tradition, et en même temps de mesurer la distance qui la sépare de la tradition chrétienne qui, sous l’influence d’Augustin notamment, combat toute idée de solidarité entre les vivants et les morts et véhicule une conception strictement individuelle, atomique de l’âme. Dans la pensée holiste traditionnelle, l’âme n’est jamais purement individuelle, et n’est pas non plus distribuée équitablement.

C’est une erreur de s’imaginer la société médiévale comme baignant dans une foi catholique uniforme, avec seulement quelques groupes hérétiques à la marge. Comme je l’ai montré dans La Mort féerique, on se fait une bien meilleure idée de la civilisation médiévale en considérant qu’elle possède deux cultures distinctes et antagonistes, bien que s’empruntant mutuellement : il y a d’un côté la culture cléricale et latine, relativement homogène, qui possède un quasi monopole de l’écrit, et de l’autre une foisonnante culture en langues vernaculaires, principalement orale mais qui nous a laissé suffisamment de textes écrits à partir du 12e siècle (époque où se répand le papier en Occident).
Contrairement à la culture cléricale, qui s’écrit en prose et s’occupe de doctrine, la culture « laïque » valorise la poésie et la narration. Elle est d’origine aristocratique, mais imprègne les couches populaires. Elle possède sa propre religiosité, et notamment un riche imaginaire de l’Autre Monde, dans lequel l’amour tient une grande place. Elle n’hésite pas à l’occasion à afficher un anticléricalisme décomplexé. Dans Aucassin et Nicolette, « chantefable » du 12e siècle, Aucassin, menacé de l’Enfer s’il devient l’amant de Nicolette, répond qu’il préfère l’Enfer au Paradis promis par les clercs, où vont « les vieux prêtres, les vieux éclopés et les manchots qui, jour et nuit, sont à genoux devant les autels et dans de vieilles cryptes, qui ont de vieilles capes élimées et de vieux haillons, qui sont nus, sans souliers et sans chausses, qui meurent de faim, de soif, de froid et de maladie. ». Si c’est en Enfer que vont les chevaliers morts aux tournois, les belles dames courtoises et les joueurs de harpes, Aucassin pense qu’il s’y trouvera en meilleure compagnie.
Bien des lais et romans évoquent un paradis érotique, qui fait concurrence à celui des clercs. On aurait tort de n’y voir qu’ironie de mécréants. Cet imaginaire émane d’une intime conviction que l’amour est la source de la plus grande joie de l’âme. Par conséquent, le paradis ne se conçoit que dans la plénitude de cette joie, et non dans son absence. Tel est le message du célèbre Roman de la Rose, laissé inachevé par Guillaume de Lorris vers 1225-1230. Le narrateur y raconte un rêve allégorique se situant dans un jardin merveilleux où se trouve la Fontaine d’Amour, et la femme la plus belle qu’il ait jamais vue. Le dieu Amour lui décoche sa flèche dans le cœur, si profondément qu’il ne peut en retirer la pointe. Vaincu, il se soumet à Amour, comme un vassal à son seigneur. On ne doit pas sous-estimer la dimension religieuse du Roman de la Rose. Selon son traducteur Jean Dufournet, « nous trouvons dans l’œuvre de Guillaume de Lorris les éléments d’un courant spirituel très fort qui font du protagoniste un émule des mystiques. » Le dieu Amour (Amor, que certains proposent de décrypter comme l’inverse de Roma) n’est peut-être qu’une hypostase poétique, mais comment nier qu’il se pose en concurrent du Dieu catholique de l’ascèse et de la virginité ?
Denis de Rougemont et la critique de l’amour passion
Nul ne s’est penché avec plus d’acuité sur l’opposition entre romantisme et christianisme que Denis De Rougemont, l’auteur du mémorable essai sur L’Amour et l’Occident (1938) et d’un autre livre moins connu, Les Mythes de l’amour (paru sous le titre Comme toi-même en 1961). Dans ces deux livres De Rougemont tente de comprendre « ce mouvement d’aller et retour du religieux à l’érotique qui est l’un des secrets décisifs de la psyché occidentale ». Son premier argument est que le romantisme, qu’il fait remonter à l’amour courtois, est une disposition fondamentalement religieuse :
« L’Éros, c’est le Désir total, c’est l’Aspiration lumineuse, l’élan religieux originel porté à sa plus haute puissance, à l’extrême exigence de pureté qui est l’extrême exigence d’Unité. »
Son second argument est que cette religion est étrangère et opposée au catholicisme. Le contexte historique l’amène à en chercher l’origine dans le catharisme. En effet, « l’hérésie cathare et l’amour courtois se développent simultanément, dans le temps (XIIe siècle) comme dans l’espace (midi de la France). Comment croire que ces deux mouvements soient dépourvus de toute espèce de liens ? » Une explication possible de cette concordance est que « le lyrisme courtois fut au moins inspiré par l’atmosphère religieuse du catharisme ».
Mais De Rougemont penche pour une thèse plus hardie : « L’amour-passion glorifié par le mythe fut réellement au XIIe siècle, date de son apparition, une religion dans toute la force de ce terme, et spécialement une hérésie chrétienne historiquement déterminée. » Sous cette forme, sa thèse a été rejetée par la majorité des historiens. On ne peut, disent-ils, accorder l’ascétisme des cathares avec l’érotisme des troubadours. De Rougemont réplique que la fin’amor valorise, comme la morale cathare, le détachement ou la sublimation de la sexualité, du moins en théorie. Je ne suis pas qualifié pour trancher ce débat. Il me semble prudent d’en rester à une thèse minimale : la poésie courtoise et ses idées hétérodoxes ont pu se développer librement dans le climat de tolérance et de pluralisme religieux, associés à une hostilité aux prétentions hégémoniques de Rome, climat qui caractérisait tout le sud de la France jusqu’à la croisade albigeoise, et dont profita également le catharisme.
Qu’il y ait eu des seigneuries réputées à la fois bienveillantes envers les cathares et accueillantes pour les troubadours, comme le signale De Rougemont, n’implique pas nécessairement le partage d’une foi commune. Néanmoins, on peut supposer une certaine affinité entre les deux mouvements dans leur mépris relatif du mariage. Ajoutons que certains écrits cathares prêtent à Jésus une relation amoureuse avec Marie Madeleine (Marie de Magdala), la première personne à qui le Christ ressuscité est apparu (pour lui révéler des choses cachées à Pierre). Ce thème remonte aux gnostiques des premiers siècles ; les hérésiologues nous disent qu’ils considéraient Marie Madeleine comme la « concubine » du Christ, mais on doit plutôt supposer qu’ils concevaient leur relation comme platonique.
Quoiqu’il en soit, du lien génétique qu’il croit repérer entre l’amour courtois et l’hérésie, le catholique De Rougemont tire une critique général de l’amour-passion. Celui qui aime d’amour-passion, dit-il, est un égoïste qui n’aime en réalité que le sentiment d’amour qu’il éprouve. Pire, dans sa passion se trouve mêlée une attirance morbide pour la mort. Au sujet de Tristan et Iseut, héros archétypaux de l’amour-passion, De Rougemont écrit :
« L’amour de l’amour même dissimulait une passion beaucoup plus terrible, une volonté profondément inavouable. […] Sans le savoir, les amants n’ont jamais désiré que la mort ».
Il pourrait dire la même chose de Roméo et Juliette. Mais en quoi, répondra-t-on à De Rougemont, cela fait-il de l’amour-passion une pathologie ? Dit-on d’un mystique que son amour de Dieu est égoïste parce que sa joie est de se sentir aimé de Dieu ? Reproche-t-on au mystique de trouver la mort désirable et belle ? Le reproche-t-on au héros tragique ? Pourquoi le reprocherait-on à l’amoureux ? N’est-ce pas, au fond, l’affinité secrète de l’amour avec la mort qui démontre que l’amour en question est une expérience du divin, une réalité qui unit deux êtres dans une quête d’éternité (amor est a mor, l’amour est l’absence de mort, dit le trouvère Jacques de Baissieux) ? Oui, l’amour romantique est une illusion, un idéal inatteignable. Mais ne peut-on en dire autant du Royaume des Cieux que le Christ nous a appris à appeler de nos prières ? Dira-t-on que, parce que le Royaume de Dieu n’est pas de ce monde, il faut y renoncer, voire le condamner ?
À l’appui de sa critique de l’amour-passion, Denis De Rougemont remarque également qu’il est en réalité dirigé vers une femme idéale, et non une femme réelle. De fait, chez les troubadours, il est souvent difficile de savoir si la femme adorée, généralement anonyme, est réelle. Selon la légende, Jaufré Rudel, troubadour aquitain du 12e siècle, aurait entendu parler de la princesse de Tripoli et en serait tombé amoureux sans l’avoir vue : « J’ai une amie, mais je ne sais qui elle est, car jamais de par ma foi je ne la vis… et je l’aime fort. Nulle joie ne me plaît autant que la possession de cet amour lointain. » Pour la connaître néanmoins, Jaufré partit pour la deuxième croisade mais tomba malade et mourut dans les bras de sa princesse. On est en droit de soupçonner, non pas seulement une fiction, mais un message cryptique. De Rougemont n’est pas le premier à supposer que la Dame dont les troubadours chantent les louanges, et qu’ils vénèrent comme une déesse, en est littéralement une. Le caractère parfois stéréotypé de leur poésie, pauvre en descriptions personnelles, donne l’impression qu’ils adorent tous la même Dame.
Pour De Rougemont, cet aspect de la poésie des troubadours est révélateur de la nature de l’amour-passion qu’ils ont inventé : l’amant « idéalise » la femme aimée, lui attribue des perfections qu’elle ne possède pas, et en cela, c’est bien une femme « idéale », une Idée, qu’il aime. L’observation est juste, psychologiquement fondée. L’illusion amoureuse est bien rendue par la métaphore de la « cristallisation », inspirée à Stendhal par la manière dont un rameau se couvre « d’une infinité de diamants mobiles et éblouissants » lorsqu’on la plonge quelque mois dans les eaux d’une mine de sel. Mais ces diamants n’existent-ils que dans les yeux de l’amant ? Est-ce une hallucination, ou bien la vision d’une réalité transcendante ? On ne dit pas de celui qui ressent Dieu dans la nature qu’il est victime d’une illusion. Pourquoi le dirait-on de celui qui ressent la divinité dans la femme ?

Voici donc ce qu’on peut répondre à De Rougemont : si l’amour d’une femme est en réalité dirigé vers la Femme qui se trouve au-delà, il ne s’ensuit pas que la Femme est moins réelle que la femme. Du point de vue platonicien, c’est le contraire : l’Idée Femme est plus réelle que toutes les formes particulières dans lesquelles elle s’incarne. Cette logique était naturelle pour l’homme médiéval, à une époque où il n’y avait de « psychologie » que « science de l’âme ». Dans une pensée traditionnelle où l’ici-bas est le reflet de l’au-delà, la grâce féminine est perçue comme le reflet (éphémère) de la divinité (éternelle). Nous rejoignons ici Kierkegaard : la femme particulière sur laquelle l’homme cristallise son désir éveille en lui conscience et soif d’immortalité, mais seule la Femme idéale et éternelle peut satisfaire cette soif. D’où le mystère de Don Juan, résolu par Kierkegaard : comme le poète romantique, Don Juan a compris qu’il n’y a qu’une seule femme, et que donc toutes les femmes n’en font qu’Une ; mais il pense atteindre cet universel féminin à travers le multiple plutôt que l’unique.
« Dans chaque femme, il désire la féminité tout entière […] Et c’est pourquoi toutes les différences particulières s’évanouissent devant ce qui est l’essentiel : être femme ».
De Rougemont a soulevé la question importante du caractère anticatholique de la courtoisie. Mais sa réponse par le catharisme reste peu convaincante. À quoi peut-on bien rattacher, dans le catharisme, le culte de la Dame, le secret caché de la courtoisie ? Pour autant qu’on sache, le catharisme est une hérésie chrétienne, pas une survivance païenne. De Rougemont a bien compris que la Dame vers laquelle s’élèvent les pensées des troubadours n’est pas véritablement une femme de ce monde. Pourtant, il ne s’engage pas dans la quête de son identité secrète. Tout au plus signale-t-il que, selon certains spécialistes de la mystique arabe et iranienne comme Henri Corbin, « la Dame des pensées ne serait autre que la part spirituelle et angélique de l’homme, son vrai moi. » Cette piste n’est pas sans intérêt, mais je ne crois pas qu’elle mène au cœur du mystère. Car si l’on s’arrêtait là, alors De Rougemont serait encore en-dessous de la vérité dans sa critique de l’amour courtois : il s’agirait d’un culte narcissique. Ce serait là se méprendre sur le langage des mystiques, qui lorsqu’ils évoquent la fusion de leur âme avec la divinité, ne prennent pas littéralement leur âme pour une divinité.
Par ailleurs, avant de s’aventurer en Orient, n’est-il pas raisonnable de chercher l’origine de cette mystérieuse Dame dans le Bassin méditerranéen ? La question est la suivante : si la Dame des troubadours occitans est une déesse cryptique, la connaissons-nous sous d’autres noms ? On aimerait que les troubadours nous les disent, mais ils sont muets. Et c’est heureux, car sinon leurs poèmes n’auraient pas survécu. En effet, il ne peut s’agir de la Vierge Marie, car l’érotisme n’aurait pas sa place, et le cryptage n’aurait aucun sens. Néanmoins, le culte catholique de la Vierge nous fournit une clé, par une sorte de jeu de miroir. De Rougemont pense que le culte marial catholique apparaît en réaction à la mystique des troubadours :
« À cette montée puissante et comme universelle de l’Amour et du culte de la Femme idéalisée, l’Église et le clergé ne pouvaient manquer d’opposer une croyance et un culte qui répondissent au même désir profond, surgi de l’âme collective. […] De là les tentatives multipliées, dès le début du XIIe siècle, pour instituer un culte de la Vierge. […] À la “Dame des Pensées” de la cortezia, on substituera “Notre-Dame”. »
Cette thèse est incomplète. Car on sait que le culte catholique de Notre-Dame s’est superposé au culte d’Isis, qui recevait bien avant Marie les noms de « Notre Dame », « Mère de dieu » et « Reine du Ciel ». La correspondance est incontestable : elle inclut Osiris démembré par Seth (l’ancêtre des Juifs selon certains Égyptiens cités par Plutarque) dans le rôle du Christ en croix, et Horus, fils d’Isis conçu surnaturellement par Osiris, dans le rôle de l’enfant Jésus (né comme Horus au solstice d’hiver). Les représentations romaines d’Isis tenant le jeune Horus sur ses genoux, parfois l’allaitant, sont difficiles à distinguer de celles de la Vierge à l’Enfant du premier art chrétien, car elles lui ont servi de modèles. C’est dans une démarche d’assimilation du culte d’Isis, et non d’imitation des troubadours, que Bernard de Clairvaux (1090-1153) nomme pour la première fois la mère de Jésus « Notre Dame », et élabore la liturgie de sa divinisation : « Ô Notre Dame Médiatrice couronnée de douze Étoiles, revêtue du Soleil avec la lune sous Tes pas. » En définitive, si le lyrisme marial ressemble au lyrisme courtois, ce n’est pas parce que le premier imite le second, mais plutôt parce que tous deux ont pour modèle le culte d’Isis. Ou bien, si l’on préfère : l’Église a imité le langage des troubadours parce qu’elle reconnaissait, derrière son érotisme de surface, un lyrisme religieux. Faut-il, alors, croire que les troubadours étaient des adorateurs secrets d’Isis ?

Dante et les Fidèles d’Amour
Peut-être y verrons-nous plus clair en nous intéressant à leurs héritiers de la fin du 14e siècle, particulièrement à ceux de Florence (où s’étaient réfugiés, notons-le, de nombreux cathares). Dante (1265-1321), puis Pétrarque (1304-1374) et Boccace (1313-1375) sont considérés comme les derniers poètes courtois. Et la critique se demande depuis toujours si les dames auxquelles ils ont adressé leurs plus beaux vers (respectivement Beatrix, Laura et Fiametta) sont des femmes réelles ou une Idée. Toutes, note Eugène Aroux (Dante, hérétique, révolutionnaire et socialiste, 1854), ont été prétendument rencontrées durant la semaine sainte, et toutes sont mortes peu après cette rencontre, de sorte que les poètes s’adressent à une créature désincarnée, habitant au paradis où elle se transforme en Lumière divine. Leurs amants prennent alors le titre de pèlerins, et entreprennent de grands voyages pour la retrouver.
Chez le premier d’entre eux, Dante Alighieri, on trouve de nombreuses allusions à un sens caché : « Ô ! Vous qui avez les intellects sains / Voyez la doctrine qui se cache / sous le voile de ces vers étranges » (Enfer, IX). Les poèmes de Dante sont largement inintelligibles, et plusieurs critiques italiens estiment qu’il faut un code pour les décrypter. Luigi Valli, en particulier, a publié en 1928 un livre qui fit une grande impression sur des penseurs comme René Guénon, Julius Evola ou Henri Corbin : Il linguaggio segreto di Dante e dei “Fedeli d’amore” (« Le langage secret de Dante et des “Fidèles d’Amour” »). Les « Fidèles d’Amour » que mentionne Dante aurait été un cercle ou une fraternité de poètes, principalement florentins, unis par une conception religieuse hérétique, en même temps qu’une hostilité au nouvel ordre mondial imposé par l’Église romaine. Ces poètes, écrit Valli, faisaient de leurs sentiments amoureux « une matière pour exprimer des pensées mystiques et initiatiques […] dans un langage amoureux symbolique, avec un jargon affecté ». Selon l’interprétation de Julius Evola (Métaphysique du sexe, 1934), « Les différentes femmes chantées par les Fidèles d’Amour, quels que soient leurs noms, sont, il est vrai, une femme unique, image de la “Sainte Sagesse” ou de la Gnose, donc d’un principe d’illumination, de salut et de connaissance transcendante. » L’amour qu’ils glorifient n’est pas une passion sensuelle, mais une force spirituelle qui ne peut naître que dans un cœur noble, dont il révèle la vertu latente. « En le cœur noble amour toujours s’abrite / Comme en forêt l’oiseau sous la ramée », écrit Guido Guinizzelli (1230-1276), l’un des pères spirituels de Dante.
Evola se démarque de Guénon (L’Ésotérisme de Dante, 1925) en insistant, à juste titre je crois, sur le fait que le langage amoureux de Dante et ses amis n’est pas purement symbolique d’une réalité sans rapport avec l’amour humain, mais qu’il s’agit véritablement pour eux de partir de l’amour humain pour atteindre l’essence divine de la féminité. Quant au caractère cryptique du message de Dante, il ne s’explique pas par un « ésotérisme » qui serait inhérent à sa nature, mais par son hétérodoxie radicale. N’oublions pas que Dante a été inquiété par l’Inquisition, et ne pouvait exprimer sa pensée qu’en la camouflant sous un catholicisme irréprochable. En ce sens, son « ésotérisme » est imposé par les circonstances. Francesco Stabili (1269-1327), proche de Dante, fut accusé par l’Inquisition de « mal parler » de la foi catholique et mourut sur le bûcher.
Quelques extraits de la poésie de Dante permettront de comprendre ce que cache son « langage secret ». C’est dans un récit autobiographique intitulé Vita Nova (« Vie nouvelle »), alternant prose et vers, qu’il introduit pour la première fois cette « glorieuse dame de mes pensées, que beaucoup nommèrent Béatrice, ne sachant comment la nommer » (ch. II). Un jour, dit-il, Béatrice « me salua si gracieusement qu’il me sembla avoir atteint l’extrémité de la Béatitude » (ch. III). Dante fait souvent référence à ce saluto, « salutation », à comprendre au second degré comme salute, le « salut » religieux. Le salut de la « divine Béatrice » remplit chaque homme qui la voit de charité : « Et s’il arrive qu’elle lui accorde son salut / Il se sent si humble qu’il en oublie toutes les offenses » (ch. XIX).
« Ma Dame porte l’amour dans ses yeux, De sorte que ce qu’elle regarde s’embellit. Où elle passe chacun se tourne vers elle Et son salut fait trembler le cœur, De sorte que baissant son visage on pâlit, Et on se repent de ses propres fautes. L’orgueil et la colère s’enfuient devant elle. Aidez-moi, Mesdames, à lui faire honneur. Toute douceur, toute pensée modeste, Naissent dans le cœur de celui qui l’entend parler » (Vie nouvelle, XXI). Le récit se conclut par l’annonce d’une œuvre à venir ou il « espère dire d’elle ce qui n’a encore été dit d’aucune autre femme », avant que « mon âme puisse s’en aller contempler la gloire de sa Dame » (ch. XLIII) : c’est donc la Vie nouvelle (1292) qui donne les clés de la Comédie (commencée vers 1303), dans laquelle on trouve par exemple cet hymne à Béatrice : « Tu m’as montré le Ciel : C’est en suivant ta trace, Que j’ai compris de Dieu la puissance et la grâce. D’humble et d’esclave, un jour tu m’as fait libre et fort ; Tu m’ouvris les sentiers qui conduisent au port... Car que ne peux-tu pas, ô chère et sainte Dame ! Veille sur moi ; c’est peu d’avoir sauvé mon âme ; Rends-la digne de toi, quand, du milieu des morts, Cette âme aura quitté les vils liens du corps !... » (Paradis, XXXI)

Quelle est cette divinité bienfaisante qui a accordé au poète le salut et l’a guidé jusqu’au Paradis ? Est-elle Isis, qui promet à Apulée dans L’Âne d’or (un livre daté du 2e siècle mais bizarrement inconnu en Europe jusqu’au 13e siècle, époque où la pensée philosophique dissidente se camoufle parfois sous des noms d’auteurs antiques) : « Quand ta course terrestre sera achevée, tu me retrouveras brillant parmi les ténèbres de l’Achéron et régnant sur les demeures profondes du Styx ; toi-même, habitant les Champs-Élysées, tu rendras un hommage assidu à ma divinité » ? Sans doute. Mais Isis est la déesse myrionyme (« aux dix mille noms »), et chacun la chante sous un nom différent. Dino Compagni (1255-1324), autre Florentin contemporain de Dante, a donné à sa Dame le nom de Madonna Intelligenza, dans le poème du même titre :
« Alors je sentis venir de Fin Amour Un rayon qui passa dans l’intérieur du cœur Comme la lumière qui apparaît au matin […] Dans mon âme, l’Intelligence Est rentrée douce, suave et très secrète Est venue à mon cœur et a pénétré dans cette sacristie. »
Cette « Intelligence » est plus connue sous le nom de Sagesse, Sophia, ou parfois Philosophia, comme dans la Consolation de Philosophie de Boèce (524). Tandis qu’il attendait la mort dans les geôles du roi Théodoric, Philosophia lui apparut comme « une femme d’un aspect singulièrement vénérable. Ses yeux brillaient d’un éclat surhumain, et les vives couleurs qui animaient ses joues annonçaient une vigueur respectée par le temps ; […] Tantôt elle se rapetissait à la taille moyenne de l’homme ; tantôt elle paraissait toucher le ciel du front, et quand elle levait la tête plus haut encore, elle l’enfonçait dans le ciel même et se dérobait aux regards de ceux qui la contemplaient d’en bas. »
Pourquoi Sophia est-elle femme ? Voilà la grande question, la clé du lyrisme mystique des troubadours, des Fidèles d’Amour et de tous les romantiques authentiques. Kierkegaard peut nous aider à répondre : la Sagesse est l’Idée ou l’idéalité. Or celle-ci vient à l’homme par la femme. Voilà pourquoi Sophia est une Femme. Et c’est bien elle la véritable « Dame de nos pensées », celle dont nous contemplons la beauté parfaite, par le miracle de la cristallisation, dans les traits imparfaits de l’élue du cœur. Telle est la réalisation, l’illumination que Dante a voulu nous transmettre, par exemple lorsqu’il décrit la situation suivante : « entre elle et moi en ligne droite était assise une dame d’une figure très agréable, qui me regardait souvent, étonnée de mon regard qui paraissait s’arrêter sur elle » (Vita Nova, V). Ou encore au chapitre XXVII :
« Je dis que ma Dame montrait tant de grâce que non seulement elle était un objet d’honneur et de louange, mais qu’à cause d’elle bien d’autres étaient louées et honorées. Ce que voyant, et voulant le faire connaître à ceux qui ne le voyaient pas, je résolus de l’exprimer d’une manière significative ; et je dis dans le sonnet suivant l’influence que sa vertu exerçait sur les autres femmes. Celui qui voit ma Dame au milieu des autres femmes Voit parfaitement toute beauté et toute vertu. Celles qui vont avec elle doivent Remercier Dieu de la grande grâce qui leur est faite. Et sa beauté est douée d’une vertu telle Qu’elle n’éveille aucune envie Et qu’elle revêt les autres De noblesse, d’amour et de foi » (Vita Nova, XXVII).
Un contresens, qui nous empêcherait de comprendre en quoi Sophia est féminin et sourit à l’homme par le charme féminin, serait de la confondre avec Logos, comme on l’entend dire parfois. Si le Logos est la rationalité, Sophia est tout autre chose : elle est la connaissance du cœur, a rapprocher de Gnosis. Sophia est la déesse des poètes, pas des « intellectuels ». C’est pourquoi Érasme (1467-1536), le type même de l’intellectuel sans passion (et donc sans génie), ne vivant que dans les livres, l’a ridiculisée sous les traits de Dame Stultitia (« Dame Folie »), qui selon lui mène les hommes par la passion du cœur et l’illusion de l’immortalité (Éloge de la Folie).
La lumière romantique de Sophia
La poésie est la religion de l’amour. Avec Dante, elle nous dévoile des dimensions insoupçonnées du vulgaire. Elle ouvre l’accès à un monde divin délaissé et même livré au diable par le christianisme : le royaume de la Dame, Isis, Sophia. C’est, à l’évidence, une religion confidentielle. Le « salut » de Béatrice n’est pas donné à tout le monde. Pour cette raison, on pourrait contester que ce courant poético-religieux constitue une part vitale de la civilisation occidentale. Mais les impulsions culturelles viennent toujours d’une élite, et ce n’est que progressivement qu’elles ensemencent la culture populaire. Même le christianisme suit cette pente : les mystiques chrétiens n’ont jamais été plus nombreux que les Fidèles d’Amour.
Pour illustrer ce processus largement mystérieux par lequel quelques âmes supérieures ont pu canaliser et diffuser la lumière de Sophia, évoquons un autre Florentin, Léonard de Vinci (1452-1519). L’énigme de sa Mona Lisa semble faire écho à celle de la Béatrice de Dante. Tout comme pour Béatrice, les érudits disent connaître son identité : Dame Lisa (Mona est un diminutif de Madonna, contraction de Ma Donna) serait l’épouse d’un riche marchand qui aurait commandé ce portrait au peintre, alors au sommet de sa gloire. Mais Léonard y travailla de manière continue pendant dix ans, avec une dévotion extraordinaire, y superposant religieusement des milliers de touches de peintures et de vernis d’une finesse extrême. Il ne s’en sépara jamais jusqu’à sa mort. On peut dire qu’il a mis toute son âme dans cette œuvre. Ce tableau, qui ne respecte aucun des codes du portrait de l’époque (absence de bijou, par exemple) n’est en vérité pas le portrait d’une dame, mais bien l’icône de la Dame. D’où la vénération très particulière qui s’est transmise de génération en génération pour cette œuvre sans équivalent. Elle ressemble bien à la Vierge Marie, mais ce n’est pas elle, ou plutôt c’est son modèle originel recréé par Léonard. On a vu dans le fin voile noir dont Mona Lisa (l’Isa, soit l’Isis ?) s’est découverte pour le rejeter sur son épaule gauche, une référence au fameux voile d’Isis mentionné par Plutarque, que « nul mortel n’a jamais soulevé ». Laissons la parole à Théophile Gautier, qui a célébré « l’attrait invincible » de « cet être étrange avec son regard qui promet des voluptés inconnues et son expression divinement ironique », semblant cacher « des secrets interdits aux profanes » :
« Ne dirait-on pas que la Joconde est l’Isis d’une religion cryptique qui, se croyant seule, entr’ouvre les plis de son voile, dût l’imprudent qui la surprendrait devenir fou et mourir ? Jamais l’idéal féminin n’a revêtu de formes plus inéluctablement séduisantes. Croyez que si don Juan avait rencontré la Mona Lisa, il se serait épargné d’écrire sur sa liste trois mille noms de femmes ; il n’en aurait tracé qu’un, et les ailes de son désir eussent refusé de le porter plus loin. Elles se seraient fondues et déplumées au soleil noir de ces prunelles. Nous l’avons revue bien des fois, cette adorable Joconde, et notre déclaration d’amour ne nous paraît pas aujourd’hui trop brûlante. Elle est toujours là, souriant avec une moqueuse volupté à ses innombrables amants. Sur son front repose cette sérénité d’une femme sûre d’être éternellement belle et qui se sent supérieure à l’idéal de tous les poètes et de tous les artistes. » (Guide de l’amateur au Musée du Louvre, 1882)

Les romantiques ont été fascinés par ce tableau et ont beaucoup contribué à sa renommée mythique. Sur le plan littéraire, le romantisme est bien la preuve que l’ars amandi et la mystique de l’amour qui se sont élaborées dans les hautes cours princières du Moyen Âge ont fait leur chemin jusqu’à influencer l’imaginaire et les mœurs de peuples entiers. Car il est incontestable que le romantisme, sous toutes ses formes artistiques, a contribué de façon décisive aux cultures nationales européennes. Certes, tout ce qui vient d’en haut ne parvient pas nécessairement jusqu’en bas ; les éléments les plus subtils se dispersent avant d’atteindre les masses. Ce sont des graines qui ne germent pas partout en même temps (relire la parabole évangélique du semeur). Il n’empêche que cette religion initiatique de l’amour, née chez quelques âmes d’élites, a progressivement élevé spirituellement et moralement l’âme collective de l’Occident, dans une mesure tout à fait comparable et complémentaire du christianisme.
Tous les romantiques n’ont pas pénétré jusqu’au cœur du mystère de la Femme. En Allemagne, peu se comparent à Novalis, dont la parole inachevée résonna pendant un siècle (et notons en passant que la jeune fille dont l’amour et la mort firent de lui ce génie prophétique s’appelait Sophie). En France, les romantiques purs se comptent sur les doigts d’une main, et l’on a même pu dire qu’il n’y en eut qu’un seul : Gérard de Nerval (1808-1855). Aurélia, son dernier ouvrage (l’auteur fut retrouvé pendu peu après l’avoir achevé), commence ainsi :
« Une dame que j’avais aimée longtemps, et que j’appellerai du nom d’Aurélia, était perdue pour moi. Peu importent les circonstances de cet événement qui devait avoir une si grande influence sur ma vie. Chacun peut chercher dans ses souvenirs l’émotion la plus navrante, le coup le plus terrible frappé sur l’âme par le destin ; il faut alors se résoudre à mourir ou à vivre : — je dirai plus tard pourquoi je n’ai pas choisi la mort. Condamné par celle que j’aimais, coupable d’une faute dont je n’espérais plus le pardon, il ne me restait qu’à me jeter dans les enivrements vulgaires… »
Un soir, lors d’un séjour à Paris, une vision le convainc qu’il n’a plus qu’un seul jour à vivre. Il tombe gravement malade et ses rêves le transportent dans le monde des morts. Dans l’un d’eux lui apparaît une dame d’une beauté surhumaine :
« elle se mit à grandir sous un clair rayon de lumière, de telle sorte que peu à peu le jardin prenait sa forme, et les parterres et les arbres devenaient les rosaces et les festons de ses vêtements ; tandis que sa figure et ses bras imprimaient leurs contours aux nuages pourprés du ciel. Je la perdais ainsi de vue à mesure qu’elle se transfigurait, car elle semblait s’évanouir dans sa propre grandeur. »
Dans cette déesse qui se confond avec la Nature, il reconnaît les traits d’Aurélia. « Ce rêve si heureux à son début me jeta dans une grande perplexité. Que signifiait-il ? Je ne le sus que plus tard. Aurélia était morte. » Ainsi Aurélia est devenue pour lui la Femme, la Déesse.
« Pendant mon sommeil, j’eus une vision merveilleuse. Il me semblait que la déesse m’apparaissait, me disant : “Je suis la même que Marie, la même que ta mère, la même aussi que sous toutes les formes tu as toujours aimée. À chacune de tes épreuves, j’ai quitté l’un des masques dont je voile mes traits, et bientôt tu me verras telle que je suis…” »
« Je reportai ma pensée à l’éternelle Isis, la mère et l’épouse sacrée ; toutes mes aspirations, toutes mes prières se confondaient dans ce nom magique, je me sentais revivre en elle, et parfois elle m’apparaissait sous la figure de la Vénus antique, parfois aussi sous les traits de la Vierge des chrétiens. »
Conclusion
Il y aurait tout un livre à écrire sur cette grande tradition qui va du lyrisme courtois au romantisme, dont le thème constant est la capacité mystérieuse de l’amour de faire apparaître la divinité dans la femme aimée. Ce mystère, sans doute aussi vieux que le monde, en tout cas plus vieux que le christianisme, défie toute rationalité et ne s’exprime que par l’art, de sorte que cette déesse aux mille noms et aux mille visages est véritablement la Muse universelle. La divine Sophia est traitée en étrangère dans la chrétienté. Mais certains ont tout de même tenté de lui faire une petite place dans la théologie trinitaire. D’ailleurs, par un mystère qui reste à éclaircir, l’empereur Justinien a donné son nom à la basilique qu’il a construite au 6e siècle, Hagia Sophia. C’est la preuve qu’à Byzance les deux religions du Christ et de Sophie (ou la philosophie) faisaient bon ménage. C’est le catholicisme qui a fait la guerre à Sophia, et pour la déshériter a inventé une improbable « sainte Sophie » suppliciée à Rome avec ses trois filles Foi, Espérance et Charité. En Russie, Sophia a montré sous doux visage à quelques mystiques chrétiens jusqu’au 19e siècle. Elle illumina le philosophe et poète Vladimir Soloviev (1853-1900), sous la forme d’un être féminin céleste qui lui fit sentir que « Tout l’Univers n’était que Beauté de la Femme » (Trois rencontres). Sa première expérience eut lieu à 20 ans lorsque, durant un voyage en train, le visage d’une jolie voyageuse lui apparut comme transfiguré : « Je sentais, je savais qu’en cette unique image étaient toutes choses, j’aimais d’un nouvel amour, infini, qui embrassait tout et, en lui, je sentais, pour la premier fois toute la plénitude et le sens de la vie. » Soloviev est l’inspirateur d’une « sophiologie » qui tente de réconcilier la doctrine trinitaire et la notion platonique de la Sagesse divine, mais que condamna l’orthodoxie.

Il faut avouer que Sophia ressemble trop à Isis, au point de se confondre avec elle. Elle sent trop le paganisme. Pire encore, elle sent l’abomination, car elle n’est autre que cette fameuse Ashérah, némésis de Yahvé, adorée comme Reine du Ciel par les Juifs apostats que maudit le prophète Jérémie au chapitre 44 de son livre. Certes, l’expérience mystique de la Déesse a été rendue en partie accessible aux chrétiens par le culte de Notre Dame (lire mon article Marie, éternelle Reine du Ciel ). Mais en partie seulement, car son attribut essentiel, l’éros, lui a été retiré, et son incarnation exclusive dans la mère du Nazaréen a singulièrement restreint son imaginaire. C’est pourquoi la tradition de l’authentique Déesse n’a pu irriguer la civilisation chrétienne que de façon souterraine. Plus que de secret, il faut parler de cryptage, car ni la Divine Comédie ni la Joconde ne ne sont des œuvres passées inaperçues du grand public. Et il n’y a rien d’intrinsèquement occulte dans leur message. Il s’offre à l’intelligence de quiconque, touché en son âme par la grâce féminine, sera disposé à le chercher. Nous avons fait un bout de chemin avec Denis de Rougemont, qui nous a mis sur la voie du caractère religieux de l’amour courtois. Puis nous avons continué sans lui, pour tenter d’embrasser avec plus d’empathie ce que, d’un point de vue catholique, il regarde comme hérétique. Nous devons cependant, pour lui rendre entièrement justice, dire qu’il a cheminé lui aussi, entre la première édition de L’Amour et l’Occident en 1938 et la seconde en 1954. Dans celle-ci, il a tempéré sa critique de l’amour courtois, pour le considérer, non pas comme une dangereuse pathologie spirituelle, mais comme un pôle créateur de notre civilisation :
« condamner la passion en principe, ce serait vouloir supprimer l’un des pôles de notre tension créatrice. De fait cela n’est pas possible. […] J’ai tenté de faire voir et sentir les contrastes vitaux, conflits, antinomies, qui sous-tendent notre réalité ; et d’en mieux définir les termes. […] Toute ma morale, et toute mon érotique, et toute ma politique tiennent en effet dans le principe de la composition des opposés et de la mise en tension des pôles contraires. »
Et De Rougemont de souligner le danger « totalitaire » qu’il y aurait dans « toute tentative d’éliminer l’un des deux pôles de ces tensions, de le confondre avec son opposé, de le réduire à la loi de l’autre ». De Rougemont évoque même un dialogue constructif, lorsqu’il remarque que l’amour courtois « s’exprime dans des termes qui seront repris par presque tous les grands mystiques de l’Occident. » Au fond, il se rend à l’acceptation de la dynamique paradoxale et dialectique de toute chose.
Toute tradition a ses limites, destinées à être dépassées. De Rougemont a souligné celles de la religion de la Dame. Mais il faut aussi dire que cette religion et son héritage romantique ont comblé une lacune inhérente au catholicisme. Si la mystique courtoise est rentrée en conflit avec le catholicisme, c’est parce que ce dernier enseignait aux hommes que la beauté féminine, ou tout au moins l’attrait érotique qu’elle exerce sur eux, est le piège du diable. Le christianisme traditionnel a fait de la « crucifixion de l’éros » l’idéal de la sainteté. Dès lors, l’amour courtois et le romantisme ne pouvaient s’épanouir qu’en antagonisme avec le catholicisme. Cette lacune du catholicisme, et du christianisme en général, est une donnée à méditer pour notre temps : je ne crois pas que le christianisme, sous sa forme historique, puisse défendre efficacement l’amour contre les attaques qu’il subit en Occident depuis la révolution sexuelle. Car il faut le reconnaître : ce n’est pas le christianisme qui est attaqué avec une violence extrême par le féminisme, l’homosexualisme, le genrisme et le transgenrisme, sans oublier l’art moderne ; c’est le romantisme. Seul un renouveau de la mystique romantique pourra donner à la jeunesse des armes pour se protéger et se reconstruire.
À ne pas manquer,
l’analyse de Michel Clouscard sur Tristan et Iseut
en réponse à Denis de Rougemont :













 et
et  !
!