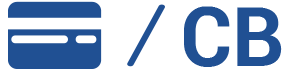Les programmes littéraires vont (comme le hasard fait bien les choses !) dans le même sens. Il s’agit de mettre au programme des œuvres susceptibles « d’éclairer » les élèves sur une série de sujets : sexualité, lutte des classes, métissage, colonisation, féminisme, etc.
Même si, d’après ce que j’ai compris, les enseignants font leur « liste de courses » dans les œuvres proposées par le ministère, l’accent est mis systématiquement sur certains auteurs (Maupassant, Zola) au détriment d’autres (Stendhal, Balzac, Flaubert), avec une overdose sur tous les modernes (de Queneau à Sarraute, en passant par Duras et Le Clézio qui doit avoir signé une convention d’exploitation avec le ministère, ce n’est pas possible autrement ! Évidemment parmi ces modernes, vous aurez l’incontournable Sartre, mais jamais Nimier, Blondin ou Laurent !). Pour le théâtre, on a gardé Molière, parce qu’il arrive toujours à faire rire, mais exit Racine, et encore une fois overdose de modernes (Brecht par exemple). Bonne partie des grands classiques de notre littérature, qui est une des plus riches et brillantes au monde, sont souverainement ignorés : trop compliqués, trop classiques, trop catholiques, trop réactionnaires (étudie-t-on Barbey d’Aurevilly ?), trop français, en un mot. Parle-t-on de Chateaubriand ? Non, mais les élèves auront droit à toute la littérature exotique célébrant le mélange des cultures. D’ailleurs l’étude de la littérature française s’efface de plus en plus au profit de la littérature étrangère.
Ce n’est pas le choix de telle ou telle œuvre (ou auteur) qui est ici contestable, mais la tendance lourde qui s’est dessinée depuis maintenant plusieurs années et qui est symptomatique de l’influence idéologique exercée. Lorsqu’il y a dix ans, j’étais en terminale, et que parmi les 4 œuvres au programme il y avait Primo Levi (Si c’est un homme), même s’il s’agit évidemment d’un témoignage autobiographique très émouvant, on ne peut pas douter un seul instant de l’intention qui se cachait derrière ce choix spécifique.
On observe, pour la littérature, comme pour l’enseignement de l’histoire, la volonté de mettre l’accent sur des grands mouvements d’ensemble, sur l’étude de « thématiques » où les œuvres se retrouvent émiettées et où l’élève n’est censé retenir que de vagues idées formatées plutôt qu’une substance littéraire profonde. Des auteurs, nous dit Belkacem, on retiendra par contre s’ils étaient ou non homosexuels !
Répondre à ce message