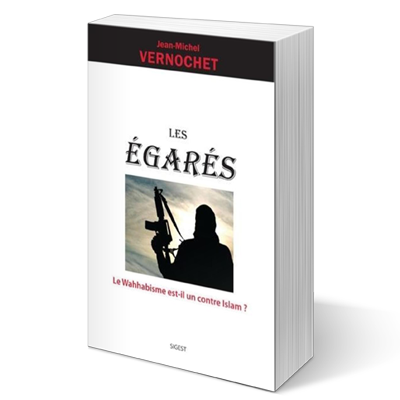Alors que l’Arabie saoudite a repris à son compte le plan qatari de renversement du régime laïque syrien, Riyad semble incapable de s’adapter au soudain recul US. Non seulement il refuse l’accord russo-américain, mais il poursuit la guerre et annonce des mesures de rétorsion pour « punir » les États-Unis. Pour Thierry Meyssan, cet entêtement équivaut à un suicide collectif de la famille des Séoud.
Lâchée par les États-Unis en Syrie, l’Arabie saoudite va t-elle se suicider à défaut de pouvoir vaincre ? C’est ce que l’on pourrait conclure des événements suivants :
Le 31 juillet 2013, le prince Bandar Ben Sultan s’est rendu en Russie où il n’a pas seulement été reçu par son homologue, le chef des services secrets, mais par le président Vladimir Poutine. Il existe deux versions de cette rencontre. Pour les Saoudiens, Bandar s’est exprimé au nom du royaume et des États-Unis. Il a proposé d’acheter pour 15 milliards de dollars d’armement russe si Moscou laissait tomber la Syrie. Pour les Russes, il s’est exprimé avec arrogance en menaçant d’envoyer des jihadistes perturber les Jeux olympiques d’hiver de Sotchi si Moscou persistait à soutenir le régime laïque de Damas, puis en cherchant à le corrompre. Quelle que soit la vérité, le président Poutine a ressenti les propos de son interlocuteur comme des insultes à la Russie.
Le 30 septembre, le prince Saoud Al-Faisal avait été inscrit à l’ordre du jour du débat général de la 68e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, mais furieux du réchauffement des relations irano-US, le ministre saoudien des Affaires étrangères est parti sans s’excuser. Dans sa colère, il a refusé que son discours, préparé et imprimé à l’avance, soit distribué aux délégations.
Le 11 octobre, le secrétaire général adjoint des Nations Unies et ancien responsable du département d’État pour le Proche-Orient, Jeffrey Feltman, recevait une délégation libanaise. Parlant au nom de M. Ban, mais probablement plus encore au nom du président Obama, il n’a pas eu de mots assez durs pour critiquer la politique étrangère saoudienne, faite de « rancunes » et incapable de s’adapter au monde qui change.
Le 18 octobre, l’Assemblée générale des nations Unies élisait, par 176 voix sur 193, l’Arabie saoudite comme membre non-permanent du Conseil de sécurité pour deux ans à compter du 1er janvier 2014. L’ambassadeur Abdallah El-Mouallemi se félicitait de cette victoire qui reflète « l’efficacité de la politique saoudienne marquée par la modération » (sic). Cependant quelques heures plus tard, le prince Saoud Al-Faisan publiait un communiqué aux accents nassériens sur l’incapacité du Conseil de sécurité et le refus du royaume d’y siéger. Si le motif officiel principal évoqué était la question syrienne, le ministre s’offrait le luxe de dénoncer également la question palestinienne et celle des armes de destruction massive au Proche-Orient, c’est-à-dire de désigner comme ennemis de la paix à la fois l’Iran et Israël. Sachant que la critique de la politique syrienne des Nations unies est une mise en cause directe de la Russie et de la Chine, qui y firent usage par trois fois de leurs droits de veto, ce communiqué était une insulte faite à Pékin, bien que la Chine soit le principal client actuel du pétrole saoudien. Cette volte-face, qui plongea l’Organisation dans la consternation, fut néanmoins bruyamment saluée par les présidents de la Turquie et de la France qui déclarèrent partager les « frustrations » de l’Arabie saoudite sur la Syrie.
Le 21 octobre, le Wall Street Journal révélait que le prince Bandar Ben Sultan avait invité à son domicile des diplomates européens en poste à Riyad. Le chef des services secrets leur aurait narré la fureur saoudienne face au rapprochement irano-US et au retrait militaire US de Syrie. Devant ses hôtes interloqués, il aurait annoncé que le royaume allait en rétorsion retirer ses investissements d’Amérique. Revenant sur l’épisode du siège au Conseil de sécurité, le quotidien précisa que, selon le prince Bandar, le communiqué n’était pas dirigé contre Pékin, mais contre Washington ; une précision d’autant plus intéressante qu’elle ne correspond pas à la situation.
Face à l’incrédulité suscitée par ces déclarations et aux commentaires apaisants du département d’État, le prince Turki Ben Faisal expliqua à Reuters que les paroles de son ennemi personnel, Bandar, engageaient bien le royaume et que cette nouvelle politique ne serait pas remise en question. Il n’est donc plus question d’une division du pouvoir entre les deux branches rivales de la famille régnante, les Sudairi contre les Shuraim, mais bien de leur vision commune.
En résumé, l’Arabie saoudite insultait la Russie en juillet, la Chine il y a deux semaines, et maintenant les États-Unis. Le royaume annonce qu’il retirera ses investissements d’Amérique pour se tourner probablement vers la Turquie et la France, même si aucun expert ne voit comment cela serait possible. Deux explications de ce comportement sont possibles : soit Riyad feint la colère pour permettre à Washington de continuer la guerre en Syrie sans en prendre la responsabilité, soit la famille des Séoud commet un suicide politique.
La première hypothèse semble infirmée par la sortie du prince Bandar devant les ambassadeurs européens. S’il jouait en sous-main pour les États-Unis, il s’abstiendrait de venir prêcher la révolution auprès de leurs alliés.
La seconde hypothèse rappelle le comportement des chameaux, animaux fétiches des bédouins saoudiens. Ils sont réputés capables de se laisser animer durant des années par leurs rancunes et de ne pas trouver le calme avant d’avoir assouvi leur vengeance, quel qu’en soit le prix à payer.
Or, la survie de l’Arabie saoudite est en jeu depuis la nomination de John O. Brennan à la tête de la CIA, en mars 2013. Jadis en poste en Arabie, c’est un adversaire résolu du dispositif mis en place par ses prédécesseurs avec Riyad : le jihadisme international. M. Brennan considère que si ces combattants ont fait du bon boulot, jadis, en Afghanistan, en Yougoslavie et en Tchétchénie, ils sont devenus à la fois trop nombreux et ingérables. Ce qui était au départ quelques extrémistes arabes partis faire le coup de feu contre l’Armée rouge est devenu une constellation de groupes, présents du Maroc à la Chine, qui se battent en définitive bien plus pour faire triompher le modèle saoudien de société que pour vaincre les adversaires des États-Unis. Déjà, en 2001, les États-Unis avaient pensé éliminer Al-Qaïda en le rendant responsable des attentats du 11 septembre. Cependant, avec l’assassinat officiel d’Oussama Ben Laden, en mai 2011, ils avaient décidé de réhabiliter ce système et en firent très grand usage en Libye et en Syrie. Jamais sans Al-Qaïda, Mouamar el-Kadhafi aurait pu être renversé comme l’atteste aujourd’hui la présence d’Abdelhakim Belhaj, ex-numéro 2 de l’organisation, comme gouverneur militaire de Tripoli. Quoi qu’il en soit, aux yeux de John O. Brennan, le jihadisme international devrait être ramené à de faibles proportions et n’être conservé que comme force d’appoint de la CIA en certaines occasions.
Le jihadisme est non seulement la seule force effective de l’Arabie saoudite, dont l’armée est divisée en deux unités obéissant aux deux clans de la famille des Séoud, mais c’est aussi son unique raison d’être. Washington n’a plus besoin du royaume pour se fournir en hydrocarbures, ni pour plaider la cause de la paix avec Israël. D’où le retour au Pentagone du vieux plan néoconservateur : « Jeter les Séoud hors d’Arabie », selon le titre d’un Powerpoint projeté en juillet 2002 devant le Conseil politique du département de la Défense. Ce projet prévoit le démantèlement du pays en cinq zones distinctes, dont trois sont appelées à former des États indépendants les uns des autres et deux devraient être rattachés à d’autres États.
En choisissant l’épreuve de force avec les États-Unis, la famille des Séoud ne leur donne pas le choix. Il est improbable que Washington se laisse dicter sa conduite par quelques bédouins fortunés, mais prévisible qu’il va les remettre au pas. En 1975, ils n’hésitèrent pas à faire assassiner le roi Faysal. Cette fois, ils devraient être plus radicaux encore.













 et
et  !
!