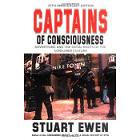De nouveaux rapports de production nés du fordisme ont entraîné le passage à une nouvelle anthropologie. Celle-ci fut contrainte afin de correspondre aux canons du marché « consommatiste ». Loin de jouer sur les simples lois de l’offre et de la demande, cette ingénierie sociale chercha à influer sur les comportements par la promotion d’un modèle social qui pérenniserait la société nouvelle.
Loin de chercher à satisfaire le consommateur, qui ne consommerait plus et entraînerait la mort du système, publicitaires, industriels et chercheurs en sciences sociales œuvrèrent de concert pour détruire les réticences des familles traditionnelles – en s’appuyant notamment sur le management, nouvelle organisation du travail. Une « théorie générale des instincts » fut développée et appliquée à l’homme. Contrôlant et régulant sa vie, l’appel et l’exacerbation permanents des pulsions neutralisèrent et éradiquèrent progressivement la critique anticapitaliste encore vivace. Cette dernière devait être réinjectée, de gré ou de force, dans la consommation de masse.
Dès 1976, dans le sulfureux et hautement subversif Consciences sous influence. Publicité et genèse de la société de consommation, l’historien de la publicité Stuart Ewen posait la question essentielle : « Pourquoi, comment et au bénéfice de qui » opère la manipulation consommatiste ? Réponse simple : un pouvoir autonomisé de la sphère sociale entend faire triompher ses intérêts, de préférence sans que les sujets n’en aient conscience. Ici, l’acception est bien entendu cognitive : le titre original est Captains of Consciousness, Les Capitaines de Conscience.
L’innovation fordiste de 1910 instaura la production de masse à la chaîne. Concurrence oblige, le mimétisme gangréna les rivaux. Mais, obstacle moral des ouvriers enracinés obligeant, la demande ne suivait pas l’offre massive. Le peuple se passait bien des achats compulsifs pour y préférer le principe d’épargne. Or, question de survie, les entreprises devaient étendre constamment leur marché (d’où les vraies raisons du plan Marshall ultérieur).
Bonus sur le gain financier, une conversion de masse à la société de consommation apporterait la paix sociale aux puissants. Le consommatisme, « participation des foules aux idéaux du marché industriel de masse », canaliserait et résorberait l’insatisfaction au travers de l’achat – toujours renouvelé – de biens. Ce point est décisif : la satisfaction du consommateur est un mensonge dès le départ. Le consommateur satisfait cesse de consommer et signe dès lors la mort d’une telle société et de son économie. Car dans une société de croissance, « que se passerait-il une fois que le consommateur aurait satisfait tous ses besoins ? » [1].
Les têtes pensantes de ce système étaient conscientes de la nécessité d’organiser tant la demande que l’offre. Nous sortions du modèle fordiste, dont le « Service sociologique » avait pour mandat de se rendre dans les foyers ouvriers pour vérifier la consommation d’alcool, la vie amoureuse et le degré de moralité général des travailleurs qu’il employait.
À partir des années 1920, la campagne pour une consommation de masse fut lancée, entraînant une progression moyenne de la croissance des sociétés industrielles de 286 % entre 1922 et 1929. Ford s’aligna sur la stratégie de Sloan après 1927, ce qui avait entraîné une explosion de la vente d’automobiles, qui fit suivre le même mouvement à l’économie étatsunienne. Pour vaincre les réticences, le patron de General Motors Alfred Sloan avait entrepris d’habituer les travailleurs à répondre aux exigences de la production de masse. Il concurrença Ford sur le marché automobile avec pour base des critères esthétiques aux variations annuelles – afin de pousser le consommateur à changer de véhicule tous les trois ans. Le bras armé de cette mutation fut la publicité (qui n’apparut qu’une quinzaine d’années plus tard en France avec la figure de Marcel Bleustein-Blanchet, fondateur de Publicis). Ewen analyse : « La publicité moderne doit être considérée comme une réponse immédiate aux besoins du capitalisme industriel de masse. » Elle aida l’industrie à stimuler la demande plus qu’à l’entretenir.
Comment organiser cette vaste arnaque ? En premier lieu, sur un plan strictement technique, en organisant l’obsolescence programmée, que son futur promoteur Brook Stevens définissait comme la « volonté de la part du consommateur de posséder un bien un peu plus neuf, un peu plus tôt que nécessaire ». Serge Latouche la définit comme l’un des trois instruments fondamentaux de la société de consommation, avec la publicité et le crédit (au lieu de l’épargne). Les industriels requirent de leurs ingénieurs la confection d’objets plus fragiles et le raccourcissement de leur durée de vie. Suite à sa rencontre privée au Noël 1924, le cartel Phoebus, réunion de fabricants d’ampoules de nombreux pays, prescrivit une réduction effective de la durée de vie de cet objet à mille heures. La publicité légitima comme toujours ce type de procédés. Dans les années 1950, l’obsolescence programmée devint définitivement la matrice de la société consommatiste, l’american way of life.
En second lieu, une « théorie générale des instincts » fut mise au point. Il fallait créer chez l’homme des pulsions le poussant à l’achat. Industriels et publicitaires en appelèrent aux psychologues et chercheurs en sciences sociales. L’enjeu ? Réussir la décognition d’un sujet humain – via ses « structures affectives fondamentales » – rééduqué contextuellement en osmose avec les besoins du marché.
La psychologie expérimentale alors en plein essor tomba à point nommé. Dans la logique publicitaire, une image, un propos doivent déclencher une réaction d’achat chez le sujet. Certains comme l’expert en spin Edward Bernays (double neveu de Freud, tiens) comprirent profondément le fonctionnement du psychisme humain sans connaissances neuro-physiologiques. Dans le cas d’un réflexe conditionné (cf. Pavlov) poussant le sujet à se détourner d’une réclame, pousser au consommatisme suppose d’opérer une désinhibition. Le mécanisme actif le plus efficace sera alors l’appel au prélogisme des individus, sur la base de leurs instincts. Si les processus dynamogènes stimulant l’activité d’une zone cérébrale sont absents, il suffira de provoquer les conditions propres à leur activation. Dans la pub, l’érotisme, particulièrement prégnant et qui en appelle aux pulsions sexuelles de l’homme, ou le management négatif par la peur, etc. Mais également la survie, habile retournement des ingénieurs sociaux pour dépolitiser les conflits.
Ewen rappelle que les « experts » justifièrent les licenciements pour mauvaise haleine (rebaptisée halitosis pour lui conférer le poids de la scientificité). L’interchangeabilité professionnelle consacra la valorisation sur simple critère physique et réputation de dévouement. Dès lors, l’homme victime devenait le coupable, et ne trouverait son salut qu’au travers des produits de la production de masse. Avec son succès décrit en termes simplement narcissiques (soin de l’image, de l’haleine, du corps, etc.), une nouvelle anthropologie émergea, destinée à faire adopter « une vision mercantilisée de la “Civilisation” ».
La suite est connue, le management s’est généralisé. Pour optimiser l’efficacité, les tâches sont routinisées, l’activité est régulée, les solidarités brisées par la « polyvalence des tâches », toute possibilité d’esprit critique désamorcée. L’argent gagné est réinjecté dans la consommation. Rodin parle d’ailleurs de « dualité consanguine du travail et du loisir ». L’avènement du tertiaire a poursuivi l’œuvre des « capitaines de conscience », en s’instillant dans le champ cognitif pour faire intérioriser ses normes : la rationalité contre l’instinct et l’intuition. En somme, passer outre cette common decency (décence ordinaire) chère à George Orwell, bon sens ancré dans la mentalité des gens ordinaires. Le management entend fabriquer le consentement, façonner certaines dispositions psychologiques et comportementales : la régression fonctionnaliste au service de la finance contre le bon sens et l’expérience, dixit Rodin. Un darwinisme socio-économique, où seuls les plus flexibles survivent.
Socialement, la prétention émancipatrice est une tartufferie. La société de consommation dirige de manière larvée vers l’homogénéisation. La publicité crée un caractère national homogène, « l’individu sériel (nom de code : “Américain civilisé”) ». La prétention à la civilisation n’est alors qu’un abus de langage destiné à rendre tout sujet conforme à la vision sociale des industriels, ce que confirme Ewen : « Dans la mesure où les images publicitaires du “bien-être” disaient aux Américains comment il fallait vivre, le climat social et politique donnait une bonne idée des limites de ce qui serait toléré. Avoir l’air différent, une conduite différente, des idées différentes, voilà qui devenait le critère vague de la subversion et de l’impiété. » Bref, une expérience de Asch hypocrite, un totalitarisme de tarlouzes appuyé sur des dissonances cognitives à répétition.
En fin de compte, la publicité entretient les désirs et la rivalité mimétique. L’alternative dans le refus ou l’acceptation d’un tel modèle est de penser ou dé-penser, selon Lagneau, le préfacier d’Ewen. Publicité et industriels provoquent ainsi volontairement une régression intellectuelle, notamment en s’appuyant sur le cinéma et la télévision pour éduquer les masses dans un sens conforme au marché – la télévision étant le medium le plus influent au vu de la part de la population équipée. La famille ouvrière traditionnelle était sans cesse raillée et affectée de toutes les tares, et l’homme poussé à investir tout son temps libre dans les activités consommatistes. Publicité et consommation devaient jouer un rôle social, et la nouvelle idéologie servait d’arme prophylactique au service des grandes entreprises.
Dans l’éducation, tout élément conflictuel devait être éliminé du champ du savoir. Consciences sous influence aide ainsi à comprendre l’École française, « démocratisation » signifiant « indexation » sur les vœux de l’ingénierie sociale. Le publicitaire et psychologue Edward Filene promouvait pour sa part la démission paternelle, à l’appui de soi-disant analyses scientifiques. Dans l’Amérique des années 1920-1930, la famille ne définirait plus les normes du progrès social, cela reviendrait aux sociétés anonymes et à la publicité. Désormais, la marque officierait en tant que substitut de père, de modèle. Mais puisque les habitudes des adultes restaient quelque peu difficiles à changer, industriels et publicitaires – le psychologue Alfred Poffenberger notamment – dirigèrent leur propagande sur les jeunes, en créant les catégories sociales de l’enfant et de l’adolescent, « périodes de la vie définies par leur rapport de pure consommation à la société civile » et donc nouveaux leviers potentiels de l’économie [2].
Le rôle de chaque membre de la famille fut redéfini par les annonceurs publicitaires. Les vieux se retrouvaient exclus au profit de l’enfant et de l’encensement du jeunisme. L’esprit traditionnel était renié, les jeunes désencastrés des valeurs familiales et soumis aux produits de masse. La femme représentait également un enjeu de taille. Les publicitaires remarquaient, en 1929, que 80 % des achats familiaux dépendaient d’elle. Elle constituait donc un agent de promotion privilégié pour la diffusion de la nouvelle culture de masse. Leur nouveau devoir, décrétèrent les agents du désordre, devait consister à orienter la consommation du foyer. Et puisque l’esthétique, avons-nous vu, primait désormais, la publicité créait et encensait les exigences de ce type – d’où l’omniprésente sexualisation du corps féminin.
Parallèlement, l’essor de cette nouvelle économie permit aux industriels de faire valoir leur rôle social indispensable et de s’introduire ainsi durablement dans la direction des affaires politiques. Ils promurent pour cela une éducation industrialisée devenue culture, dite de masse, bâtie sur les ruines de la culture populaire à laquelle elle se substitua. De plus, la presse passa progressivement sous contrôle d’un seul organe d’information, pour qu’en 1930, « les quatre cinquièmes des villes américaines [eussent] laissé s’installer un monopole de presse » [3].
Désormais, les fournisseurs de publicité contrôlaient les tendances économiques et politiques des journaux. La publicité créait la nouvelle réalité en décrétant ce qui en faisait ou non partie. Les publicitaires espéraient que le langage de la réclame deviendrait le nouveau langage de la culture populaire. Bien plus pernicieux, précise Ewen, la publicité serait amenée à « remplacer l’information de façon telle qu’elle surpasserait la culture traditionnelle dans ses capacités d’action sur les comportements » L’information devenait désinformation massive et le coup d’État consommatiste effectif.













 et
et  !
!