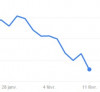Aucune autorité politique ou financière ne semble avoir tiré les leçons de la grande crise de 2008, qui a failli faire s’écrouler toute l’économie mondiale. Un nouveau krach est-il possible ?
Il est même probable. Nombre d’économistes s’attendent à une récession générale, à une avalanche de faillites, à un krach obligataire, voire à immense crise d’insolvabilité résultant de l’explosion des dettes accumulées. Certains n’hésitent pas à prédire l’effondrement du dollar, sur fond de retour à la guerre des monnaies et de fragilité grandissante d’un système monétaire dépourvu de tout ancrage extérieur depuis 1971. D’autres n’hésitent pas à parler de désastre historique ou de catastrophe planétaire. L’idée générale est qu’on est assis sur un baril de poudre, la seule question étant de savoir quel sera le détonateur.
Les signaux d’alarme ne manquent pas : chute du cours des matières premières, ralentissement de l’économie chinoise, effondrement des actions de la Deutsche Bank, pertes enregistrées par les valeurs technologiques, faillites de plusieurs banques régionales italiennes, effondrement de l’industrie manufacturière, etc. Les créances douteuses sont évaluées à mille milliards d’euros dans la seule zone euro. Quant aux produits dérivés, par lesquels s’était propagée la crise des subprimes, ils pèsent aujourd’hui deux millions de milliards de dollars, soit plus de vingt fois le PIB mondial ! Les financiers, qui sont incorrigibles, ont en outre mis au point de nouveaux moyens de contourner les règles qui les gênent (comme le « shadow banking » ou le « trading haute fréquence »). Le krach est en vue, mais tout le monde se goinfre.
Et cette fois-ci, les États surendettés n’auront plus le moyen de sauver les banques comme ils l’avaient fait il y a huit ans. La dette mondiale atteint aujourd’hui 223 000 milliards de dollars (contre 157 000 en 2008). La dette française, qui a augmenté de plus de 600 milliards d’euros sous Sarkozy, frôle les 100 % du PIB. Il n’y a plus désormais de croissance sans croissance exponentielle de la dette (on paie les dettes au moyen de nouvelles dettes). La spirale de l’endettement crée une économie qui vit au profit exclusif de ceux qui créent la monnaie de la dette.
Les banques centrales ne sont pourtant pas restées inactives ?
Pour stimuler l’économie, les banques centrales ont essentiellement eu recours à deux outils : l’assouplissement qualitatif (quantitative easing, QE) et la baisse des taux d’intérêt. Cette stratégie s’est soldée par un échec.
Les politiques d’assouplissement quantitatif, auxquelles la BCE s’est ralliée fin 2014, ont pour but d’alimenter les institutions financières et les banques en liquidités sous la forme d’achats d’une certaine quantité d’obligations (dettes financières, titres de créances) et d’actifs de long terme, notamment de titres d’État. L’argent ainsi créé est censé contrer les tendances déflationnistes de l’économie. Or, cela n’a pas marché. Les liquidités supplémentaires, loin d’atteindre et d’irriguer l’économie réelle, sont restées circonscrites dans le secteur bancaire et n’ont profité qu’aux détenteurs d’actifs financiers, qui s’en sont servis pour spéculer, ce qui a entraîné la formation de nouvelles bulles (financières, boursières, obligataires et immobilières) représentant autant de menaces.
L’abaissement des taux d’intérêt, allant jusqu’à l’adoption de taux zéro, voire parfois de taux négatif – ce qui signifie que les banques centrales payent pour prêter aux banques dans l’espoir d’inciter les acteurs économiques à faire circuler l’argent (signalons au passage que, depuis août 2014, la France emprunte elle-même à des taux négatifs) –, n’a pas eu de meilleurs résultats. Il a même paradoxalement abouti à un rationnement du crédit, au détriment notamment des PME, qui représentent près de 60 % de la croissance de la valeur ajoutée dans l’Union européenne. Les taux négatifs sont en outre très défavorables à l’épargne (ils impliquent que sa valeur diminue régulièrement).
La combinaison de liquidités abondantes et de taux extrêmement bas encourage en fait les États à s’endetter encore plus et suscite une recherche frénétique de profit de la part des investisseurs. Comme la demande d’actifs bien rémunérés dépasse l’offre, le prix du risque baisse. Au moindre incident, les investisseurs ont tendance à vendre en catastrophe. L’effondrement du prix des actifs fait alors boule de neige, contaminant ainsi tous les marchés.
Le capitalisme mondialisé est-il devenu conjoncturellement fou, ou l’était-il structurellement dès l’origine ?
Nous sommes devant une crise systémique.













 et
et  !
!