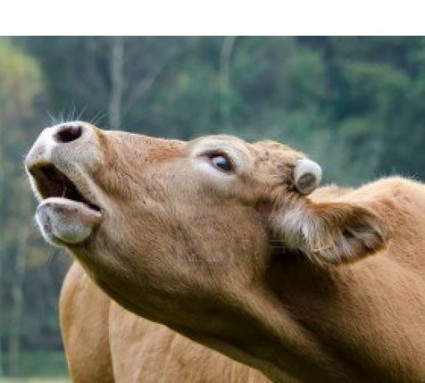Ils bloquent les routes, attaquent les hypermarchés, mettent la pression sur la grande distribution et le gouvernement : la jacquerie des éleveurs brise la quiétude d’un été chaud. Mais les jeux sont faits : les éleveurs sont pris dans un étau, entre la concurrence mondiale déloyale et la structure inadaptée de leurs exploitations.

Comparativement à son collègue allemand, brésilien ou américain, l’éleveur français travaille à petite échelle, à moins de 100 bêtes, pour un revenu moyen en dessous du Smic. Peu organisé collectivement, il ne peut tenir tête à la « grande distrib », qui fixe les prix, et étrangle les fournisseurs. Mais la puissance du distributeur n’est pas l’apanage des éleveurs : tout les producteurs y passent. Non, ce qui fait la particularité de l’éleveur français, c’est, paradoxalement, la qualité supérieure de sa viande due à la sous-industrialisation de son entreprise. Si en termes de prix il ne peut rivaliser avec ses grands voisins mondiaux, question qualité, il les bat à plate couture, même si ses vaches ne sont pas exemptes d’engraissement rapide et discret ; sans cela, ce serait la mort de la majorité des exploitations. Les Américains ont leur feedlots, les Français ont l’Italie…
Second paradoxe, la France n’est pas autosuffisante en viande, et doit en importer. D’où la chasse aux factures et autres preuves de traçage des bêtes étrangères (souvent allemandes) dans les hyper et supermarchés, quand les éleveurs font une descente. Plus, évidemment, la question du prix d’achat et de revente (autour de 5€ le kilo pour le bœuf, revendu plus du double).
Et si, au lieu de refaire l’inventaire des problèmes de la filière, nous évoquions les portes de sortie de la crise ?
Elles sont étroites, et sans pitié : la qualité, et le prix. Hausse conjuguée de ces deux facteurs, sans quoi, tout disparaîtra sous la pression de la concurrence déloyale, les portes de l’Europe et de la France étant grandes ouvertes à la production industrielle internationale de viande. Les traités commerciaux à venir ne nous laissent pas le choix : l’Europe est un gruyère. Il y aura donc deux viandes, et deux filières : une pour la grande consommation, l’autre pour un public plus exigeant, sur les critères de traçabilité, d’origines… L’éleveur français de petite envergure doit se réapproprier son terroir, qui est riche, et qui a été abandonné pour tenter de faire du chiffre et du poids. On a vu le résultat. Le modèle productiviste, dans ce domaine, est arrivé à ses limites.

Personne ne demande ici de boycotter la viande « étrangère », mais de choisir l’éleveur qui a choisi la qualité, qui vendra en boucherie (ce qui n’exclut pas la grande distrib), un peu plus cher, avec des garanties sur les circuits courts production/consommation, un respect de l’environnement, des animaux, et donc du consommateur. Car dans ce conflit, que l’aide très électorale du gouvernement (600 millions d’euros) ne résoudra pas, le consommateur est roi : c’est lui qui fixe la règle du jeu, et peut sauver la filière « qualité ». La consommation est un pouvoir, il est temps que les Français s’en aperçoivent, et l’utilisent à grande échelle. Les class actions sont interdites par le système, pas le boycott. Nous voyons tous l’efficacité du boycott de produits venant de pays qui ne respectent pas certaines règles, qualitatives, ou humanistes, par exemple…
Un jour, il est probable que les consommateurs intelligents seront organisés en syndicats ou corporations, qui auront un poids économique, et donc politique. Par exemple, le syndicat des acheteurs ou amateurs de viande de bœuf pourra « tuer » un produit trop mauvais, trop cher pour ce qu’il est, ou mensonger. Quel producteur pourra résister à un tel boycott ? Quel distributeur osera proposer dans ses rayons un produit mort-né ? Les consommateurs de viande, en attendant ce bras de fer, doivent aujourd’hui prendre en main le sauvetage de la filière. Quant aux éleveurs, accusés de tous les maux, jusqu’à se faire taxer d’empoisonneurs par des médias mal informés ou tordus, ils doivent privilégier la qualité et le terroir, car la bataille de la quantité est perdue d’avance.













 et
et  !
!